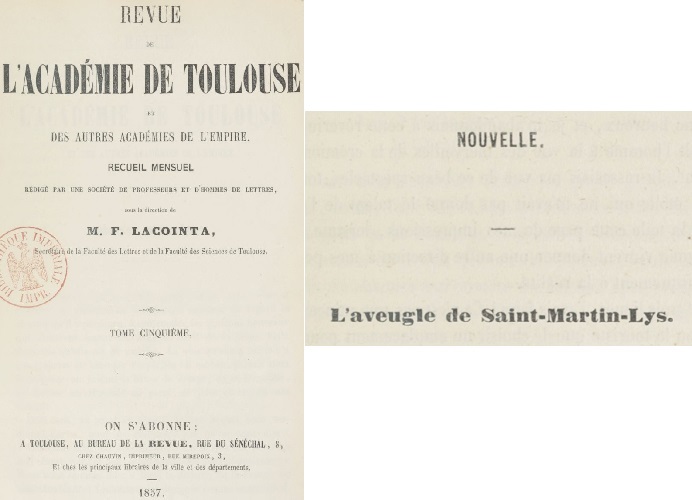
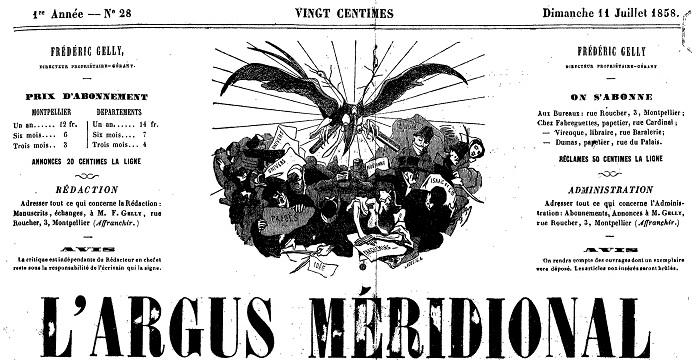
Revue ou journal éditant la nouvelle de Henri Vié-Anduze (Source gallica.bnf.fr)
En juillet 1856, poussé par un vague désir de liberté, j'étais allé dans les montagnes de l'Aude respirer un air plus pur et en parcourir de nouveau les sites imposants. J'avais pris un pied-à-terre à Quillan. Assise au pied de la Pierre-Lys, — ce paysage enlevé à la Suisse par la nature capricieuse, — cette petite ville, baignée d'eaux vives, entourée de prairies, ombragée d'arbres centenaires, s'étend paresseusement au soleil comme une italienne et se berce au bruit de ses fabriques, aux chansons de ses ouvriers.
Le calme de la campagne qui l'entoure contraste avec le mouvement de la riante cité ; car l'industrie a soufflé sur elle l'amour du travail et le goût des transactions commerciales. Du côté de la plaine, dans la direction de Limoux, l'œil embrasse des champs bien cultivés et des vignes dont le raisin aux grappes vermeilles produit un vin blanc renommé. Dans le lointain, les flancs arides de la montagne jurent, par leurs tons grisâtres, avec la végétation luxuriante de la plaine et lui composent un cadre digne d'elle. Enfin, ce pays est un de ces coins du monde que l'imagination revoit dans un doux rêve et qui, dans votre souvenir, occupent familièrement la même place que l'ami de votre enfance.
J'avais hâte de mettre le temps à profit, et dès le lendemain de mon arrivée, chaussé de souliers ferrés, un gros bâton noueux à la main, je courais dans les montagnes en touriste déterminé.
J'avais fait trois lieues, tantôt m'arrêtant à contempler cette œuvre grandiose de Félix Armand (En récompense des services qu'il avait rendus au pays, Napoléon Ier le nomma chevalier de la Légion-d'Honneur), ce modeste curé de campagne qui, inspiré par le cœur et le génie, avait creusé une route à travers les rochers à ses bons villageois de Saint-Martin-Lys ; tantôt admirant le vallon qui se déroulait à mes pieds, écoutant le bruit d'une cascade ou le clapotement joyeux d'un moulin, dont je pouvais apercevoir les murs blanchis à la chaux, entourés d'une haie de noyers et de hêtres.
J'étais donc heureux, et je m'abandonnais à cette rêverie mélancolique qui saisit l'homme à la vue des merveilles de la création et l'éclaire sur son néant. Je rassasiais ma vue de ce beau spectacle, tout en maudissant mon étoile qui ne m'avait pas donné le talent de l'artiste pour retracer sur la toile cette page de mes impressions, lorsque des tiraillements d'estomac vinrent donner une autre direction à mes pensées et me ramener brusquement à la réalité.
J'avais fait trois lieues, j'avais faim ! Ce n'est pas une mince affaire pour le chasseur ou le touriste que de choisir un emplacement pour son repas.
Habituellement, l'appétit l'assaisonne, et on est indulgent pour le menu. D'ailleurs, mon havresac était bien garni, et je le caressais du regard avec un amour qui n'était pas exempt de convoitise. L'Aude, qui coulait dans le vallon, m'envoyait son murmure doux et monotone, semblant ainsi m'inviter à déjeûner sur ses bords, et un petit bois de saules, tout près de la rivière, fixait depuis un moment mon attention. Mon choix était fait, et je descendis résolûment le sentier qui devait me conduire à mon oasis. Mais un autre avait trouvé le site à son goût, car, d'une prairie voisine, j'aperçus distinctement un homme se diriger vers le même endroit en chantant d'une voix sonore ces couplets patois d'une chanson du pays. L'écho me la renvoya.
Marioun prenguet un amourous.
Ah ! Marioun, Marioun, Mariétto !
Marioun prenguet un amourous,
Qué soul né balio pla dous !
Jougavo dé la musétto,
Ah ! Marioun, Marioun, Mariétto !
Buvio san sét ni rasou,
Ah! Mariétou !
Il continua de plus belle :
Soun curat y diguet un jour,
Ah ! Marioun, Marioun, Mariétto !
Soun curat y diguet un jour
Beïras ço qu'es qué l'amour.
D'abort serbit d'amusétto,
Ah ! Marioun, Marioun, Mariétto !
Apeï on pert la rasou,
Ah! Mariétou !
J'étais devant mon chanteur. C'était un grand garçon de vingt-cinq ans environ, brun, l'œil vif, et bien pris dans sa taille. Sa physionomie respirait la gaîté et la franchise. Il portait le costume des paysans du pays, un pantalon de treillis qui montait jusqu'à la poitrine, une veste en drap gris. Sa chemise entrouverte me laissait apercevoir une poitrine qui eût fait envie à un ténor de l'Opéra : le volume de sa voix m'était expliqué.
— Bonjour, moussu, me dit-il en soulevant son chapeau à larges bords et en fixant sur moi ses yeux .intelligents.
— Vous êtes content, à ce qu'il paraît, fis-je en forme d'introduction.
— Dam, monsieur, nous autres pauvres gens nous n'avons que la gaîté qui nous sauve.
— Voilà qui est bien pensé, mon ami, et avec cette maxime on atteint le bonheur.
Tout en parlant, je disposais sur l'herbe mon déjeûner, et je voyais aussi mon homme tirer d'un sac de toile un fromage de lait de chèvre et du pain de seigle.
— Voulez-vous partager mon déjeùner ? lui dis-je avec empressement.
— Ce n'est pas de refus, monsieur, me répondit-il en souriant; mais à une condition, c'est que vous goûterez aussi de mon fromage.
— Qu'à cela ne tienne, ce sera mon dessert.
Pendant un moment, nous fûmes occupés à satisfaire notre appétit.
Mon villageois s'acquittait à merveille de ce soin.
- Goûtez ce vin, lui dis-je, en lui versant une rasade.
- Bou Dious! quel vin ! s'écria-t-il avec enthousiasme. Voilà bien longtemps que je n'en avais bu. Il fit tout aussitôt claquer sa langue en signe de satisfaction. J'étais heureux de sa surprise.
- Voilà un bon repas, continua-t-il. Je n'avais jamais si bien mangé de ma vie. Poulet tendre, côtelettes de porc, pain qui a des yeux, vin qui pétille, fromage qui pleure; par saint Martin mon patron, l'empereur lui-même n'a rien de meilleur à se mettre dans le ventre. A votre santé, moussu! et il vida d'un trait la seconde rasade que je venais de lui verser.
Le vin le rendait communicatif. J'allumai un cigarre et lui en offris un qu'il refusa obstinément.
— Pour nous, c'est trop cher, faut pas s'y habituer, me répondit-il; et puis votre vin m'a laissé un si bon goût dans la bouche, ce serait dommage.
— Vous êtes donc bien pauvres dans votre village ?
— A Saint-Martin-Lys, ce village qui est de l'autre côté de la montagne ( et il m'indiquait le versant ouest ), tout le monde vous dira que Martin Vidal est le plus riche ; ce qui ne prouve pas que je le sois beaucoup. Un mien cousin, que j'avais à Quillan, m'a laissé cette prairie; c'est tout mon bien; il y a 8 cétérées (Deux hectares). Je suis le seul propriétaire de mon village, ce qui ne m'empêche pas de faire comme les autres, tantôt mineur ou radelier (Conducteur de radeaux sur l'Aude). Je travaille cette prairie à mes moments perdus. L'hiver, nous mangeons du pain de seigle qui date quelquefois de quinze jours ; le fromage est plus dur encore. C'est ennuyeux pour les anciens; mais les dents sont bonnes, ajouta-t-il en riant bruyamment.
— Mais enfin, lui demandai-je, touché de cette philosophie que je ne croyais qu'apparente, vous ne voudriez pas être riche ?
— Pour moi, non ; pour ma vieille mère, oui ; car, voyez-vous, mon bon monsieur, quand l'hiver je la vois essayer de mordre dans le pain dur, elle qui n'a plus de dents, ça me fend le cœur. Ah ! si j'avais seulement toujours l'avance pour acheter de la farine de maïs et lui faire manger du millas (Bouillie faite avec de la farine de maïs, très-goùtée par les gens du peuple dans le haut Languedoc) ! alors, monsieur, je me trouverais bien riche.
— Certes, vous n'êtes pas ambitieux.
— Ambitieux! ah ! ben oui 1 j'aurais trop de soucis, et je ne les aime pas. J'ai bon estomac, de bons bras : tout le monde n'en a pas autant.
Mais vous me faites bavarder, et le travail ne se fait pas.
— Touchez là, mon ami, lui dis-je en lui offrant ma main ; car le contentement de ce jeune homme m'avait réjoui le cœur, et sa nature franche avait gagné mes sympathies.
Il allait regagner sa prairie, lorsque tout-à-coup, en se retournant, il parut absorbé par la vue de deux personnes qui apparaissaient à un coude de la route. Je levai la tête ; mais ma vue n'était pas aussi bonne que celle de Martin. Je pus distinguer pourtant une femme conduisant un âne par la bride. Sur cet âne était un homme qui, à l'inclinaison de son corps abattu, paraissait en proie à la souffrantte.
— Ohé ! cria Martin de sa voix de stentor.
Le couple s'était retourné. La femme saluait de la main.
— Vous les connaissez donc ?
— Si je les connais, saquéla (Juron énergique du pays), me répondit-il, comme le Pater. C'est François et Madeleine. Mais suivez-moi, coupons par ici, nous y serons plus tôt ; vous la verrez Mattaléno, c'est la perle du pays, et brave donc, et bonne !
Je le suivis de confiance, car cet enthousiasme excitait ma curiosité.
En quelques minutes, nous eûmes franchi la distance qui nous séparait des voyageurs.
- Où allez-vous donc comme ça ? demanda Martin à la jeune femme.
- A la ville, pour soigner François, répondit-elle d'une voix dolente, en levant sur moi de grands yeux bleus qui brillaient comme des escarboucles.
— Tu sais, reprit-elle, que, le mardi, le médecin lui donne une consultation.
Je portai alors mes regards sur l'homme, et je vis qu'il était aveugle.
Sa figure, qu'un triste sourire contractait, portait les traces de profondes cicatrices et ne laissait rien d'humain à ses traits dévastés. Il était coiffé d'un képi, et à la boutonnière de sa veste de bure, j'aperçus le ruban rouge de la Légion-d'Honneur.
- Allons, du courage, dit Martin en pressant affectueusement la main du soldat. Tu guériras, mon bon François.
— Dieu t'entende ! répondit l'aveugle à mi-voix. Faites que je la voie, ô mon Dieu! ajouta-t-il en joignant les mains.
Cette courte prière et le ton dont elle fut prononcée m'avaient ému jusqu'aux larmes. Mon attendrissement n'avait pas échappé à Martin.
— A ce soir, et bon voyage ! leur cria ce dernier.
Je les suivis du regard, mais bientôt ils disparurent derrière les rochers qui surplombaient la route.
— C'est son frère? demandai-je à Martin.
— Son frère ! fit celui-ci en remuant la tête en signe de dénégation.
Ecoutez, me dit-il, vous me faites l'effet d'avoir bon cœur. Eh bien! je perdrai la moitié de ma journée, mais ça m'est égal, je vais vous raconter leur histoire.
— Oh ! bien vontiers, m'écriai-je avec joie.
Nous rejoignîmes le petit bois. Il s'assit commodément à un saule, passa la main sur son front, comme pour rassembler ses souvenirs, et après avoir toussé par précaution, il commença dans un style imagé, mélangé d'expressions patoises, le récit touchant que l'on va lire : François Domerc était, sans contredit, le plus beau garçon de la contrée. Il fallait le voir, le dimanche, quand nous descendions à la Pierre-Lys, pour aller promener avec les filles du village. C'était entre elles à qui le lutinerait le plus pour attirer son attention, et les mères disaient comme ça qu'il avait un charme, tant les têtes des petites filles se tournaient vite à son endroit ; et plus d'une était venue se promener joyeuse et sans soucis, qui s'en retourna toute réfléchie et le cœur gros.
Il était grand et fort, mais élancé et alerte. Ses yeux étaient superbes, bien fendus et ardents, comme s'ils lançaient des étincelles; ses lèvres rouges comme une fleur de grenadier ; et, chose singulière chez un homme de notre classe, ses mains étaient petites et effilées comme les plus mignonnes mains de femme. Mais il ne s'en croyait pas plus pour cela, et quand les filles disaient sur son passage : qu'un bel goujat !(Quel beau garçon) il haussait les épaules d'un air dédaigneux, car il parlait depuis longtemps à Madeleine. Il lui avait promis le mariage, et enfin, pour mieux dire, il était son galant.
Ses parents y consentaient sans peine, car pauvres tous les deux, ils étaient bien assurés de ne pas se voler l'un l'autre. Dans les villes, au contraire, il faut que vous possédiez la même fortune ou à peu prés. Ces conditions bien établies, vous bâclez l'affaire, comme vous dites, et l'amour vient plus tard.
Madeleine Vidal (car c'est ma cousine germaine) a cinq ans de moins que François ; sa mère lui a manqué bien jeune, car l'oncle Joseph s'est remarié, et comme il travaille aux mines d'Axat, il n'est pas souvent à la maison, et la marâtre en a profité pour faire passer la vie dure à ma cousine.
Il faut que je vous dise que mon oncle a eu trois enfants de son second mariage. Tout ça grouille, piaille dans la maison avec la misère pour régal ; et dans les plus mauvais jours de l'hiver, quand il n'y avait pas de pain pour calmer les cris des enfants, c'était Madeleine qui recevait des coups de la marâtre ; et cette méchante femme la traitait de fainéante.
Est-il possible d'avoir fait souffrir une aussi jolie créature du bon Dieu ?
C'est tout le portrait de ma tante Fine (Diminutif patois de Joséphine). Vous venez de la voir, ma cousine. Certes, elle est fort jolie encore, car elle n'a que vingt ans; mais le chagrin l'a un peu changée.
C'est à seize ans surtout que vous l'auriez admirée, avant qu'elle eût passé les nuits à filer, en dévorant ses larmes. Elle avait alors de petites couleurs roses sur une peau brune, mais fine comme du satin. Sa chevelure est admirable, noire comme les ailes d'un corbeau et longue d'une belle aune ; son pied tiendrait dans ma main, et ses dents, de la blancheur du lait, sont pointues comme de vraies dents de souris. Pour ses yeux, je n'en parle pas, ils brillent assez en se voilant avec pudeur sous de longs cils noirs et soyeux. Grande et souple comme un jonc, elle était, avant ses malheurs, vive et joyeuse comme un oiseau.
Tout le monde l'aimait dans le village ; et, comme bien vous le pensez, François encore plus que tout le monde.
C'est que ça venait de loin. Leurs maisons étaient voisines, et François jouait avec Madeleine, et lui donnait toujours le premier rôle dans ces petits jeux qui amusent les enfants.
Qui les avait perdus, les retrouvait ensemble. Souvent on voyait François se poser en protecteur, et lever son bras en signe de menace vers la méchante marâtre, lorsque Madeleine, la figure meurtrie, venait porter ses plaintes à celui qui plus tard devait si bien la comprendre.
Sans doute ces deux êtres étaient destinés l'un à l'autre, puisque si jeunes ils s'étaient choisis.
Je les vois encore, se tenant par la main, leurs beaux cheveux au vent, courant dans la forêt qui borde le village, à la poursuite d'un papillon, ou cherchant un nid de rouges-gorges. Un jour, Madeleine manifesta le désir d'avoir un chardonneret. François n'eut ni repos ni trêve jusqu'à ce qu'il l'eût satisfaite. Il avait alors douze ans, et grimpait sur les arbres comme un écureuil.
Nous partîmes dès l'aube, à ce moment où la forêt retentit du ramage de la fauvette et du rossignol, qui semblent par leurs chants souhaiter la bienvenue au soleil.
Dès que nous fûmes arrivés, nous tînmes conseil avec François pour savoir lequel des deux irait dénicher.
— Reste avec Madeleine, me dit-il ; c'est moi qui lui fais ce cadeau, c'est donc moi qui dois le chercher. Et, sans tenir compte de mon insistance, il escaladait un peuplier, s'aidant des tiges flexibles, faisant craquer les branches mortes, au risque de se casser le cou mille fois.
— J'ai le nid ! s'écria-t-il tout joyeux ; et avec l'avidité de l'avare qui plonge la main dans son trésor, il en retirait trois petits oiseaux qu'il enferma dans sa poitrine.
Mais au moment où il s'apprêtait à descendre, un craquement terrible se lit entendre.
- François! cria Madeleine d'une voix étranglée, en mettant la main sur ses yeux.
Le malheureux dégringolait de branche en branche : le danger était grand ; mais François, tout en tombant, étendait les mains et saisissait les branches au passage. Elles se brisaient sous le poids du corps. Il était mort, s'il n'eût rencontré une branche plus forte à laquelle il put se cramponner quelques secondes. Elle craqua bientôt comme les autres, et il tomba de quinze pieds.
— Ce n'est rien, s'écria François en se relevant.
Il voulait rassurer Madeleine qui accourait vers lui en pleurant.
— Quelle peur tu m'as faite ! te voilà tout en sang.
François avait en effet les mains et la figure meurtries en plusieurs endroits. Madeleine avait trempé son mouchoir, et étanchait le sang avec l'eau vive du ruisseau.
Il chercha alors les petits, mais il ne retira de sa poitrine que trois malheureux oiseaux écrasés : dans sa chute, il les avait tués.
— Je vais voir s'il y en a encore, dit François d'un air mutin et résolu.
— Tu n'iras pas, s'écria la petite Madeleine, dont les larmes recommencèrent à couler.
Il était déjà sur l'arbre; mais cette fois il fut prudent, et deux minutes après, il déposait un chardonneret sur les genoux de ma cousine,
— C'est le cagonis (Le dernier-né), lui dit-il avec un sourire plein de bonté ; il est bien difficile à élever, mais comme il vient de moi, tu le soigneras bien et nous le sauverons.
Madeleine le remercia d'un sourire, et nous revînmes au village, riant et sautant sur la pelouse, eux se réjouissant de cette amitié qui augmentait tous les jours ; moi, témoin heureux de leur bonheur.
Pauvres enfants ! ils ne comprenaient pas que l'amour allait bientôt remplacer l'amitié, et que, pour être réunis un jour, ils auraient à verser bien des larmes, à étouffer bien des soupirs !
Cependant ma cousine grandissait, et de plus en plus son regard se reportait sur le compagnon de son enfance. Mais elle ne s'expliquait pas la rougeur qui lui montait au front et le battement de son cœur quand elle s'approchait de François. Tout cela lui paraissait naturel ; et quand venait la nuit, elle s'endormait tranquille, en paix avec sa conscience qui ne lui reprochait rien.
François avait alors dix-neuf ans, il m'avait confié son amour et son projet de mariage. Le pauvre garçon était timide, et la seule pensée de s'avouer à Madeleine le faisait trembler comme une feuille que détache le vent d'automne.
Je me souviens d'une scène qu'il eut un jour avec la marâtre.
Cette femme battait Madeleine parce qu'elle avait brisé une écuelle.
François passait par-là revenant du travail, heureux de retrouver sa bien-aimée ; il entendit ses cris. L'enlever des bras de la méchante femme et la protéger de son corps fut pour lui l'affaire d'un instant.
- Misérable ! lui cria-t-il, à l'avenir je vous défends de la toucher. Dieu vous rendra le mai que vous lui faites.
Pour toute réponse, la marâtre lui asséna sur l'épaule un coup de fléau.
— Je pourrais vous tuer, dit-il froidement, en lui enlevant le fléau des mains ; mais je respecte votre âge, tout en vous méprisant.
A partir de ce moment, cette femme le prit en haine, et elle a essayé plus tard de lui faire payer bien cher cette parole.
François et Madeleine allaient promener souvent au bord de la rivière.
Là, le temps passait bien vite pour ces deux jeunes gens, occupés qu'ils étaient à parler de l'avenir. Puis c'étaient des parties de pêche, dont Madeleine était le témoin, et qui n'étaient qu'un prétexte que leur amour s'ingéniait à trouver. Ils se ménageaient ainsi une occasion de se voir et de se parler.
J'engageai François à dire la vérité à Madeleine ; l'époque de la conscription approchait, et si le sort lui était contraire, il ne pouvait pas emporter avec lui un secret qui n'en serait bientôt plus un pour ma cousine. Car vous devez le savoir, monsieur, les femmes ont plus que nous l'intelligence des choses du cœur.
Une occasion ne tarda pas à se présenter.
Vers la fin de juillet, j'étais allé aux gorges Saint-Georges essayer de pêcher quelques truites que je me proposais de vendre à Quillan. Le courant est en cet endroit très-rapide. Resserrée entre deux murailles de rochers taillés à pic, et s'élevant à une hauteur prodigieuse, l'Aude coule en bouillonnant, et malheur à l'imprudent qui, peu habile à la nage, oserait s'aventurer dans ce gouffre.
Je me trouvais là depuis une heure, et j'étais déjà possesseur de quelques poissons, lorsque je vis arriver François et Madeleine. Il marchait à côté d'elle rouge et embarrassé, et ma cousine avait l'air d'éprouver aussi un grand embarras.
— Bon, dis-je en moi-même, ce calme annonce l'orage.
J'avais fait la leçon à François. Pendant qu'il me remplacerait à la pêche, je devais tout dire à Madeleine. L'occasion nous servit mieux que le projet que nous avions formé. Ils s'assirent tous les deux à une distance respectueuse. Je riais sous cape de leur naïveté, et je me disais qu'à la place de François, j'aurais plus de hardiesse, lorsque tout-à-coup Madeleine s'écria : — Oh ! quelle jolie plante !
— Où est-elle? demanda François.
— Là-bas, près du gouffre dal Diablé (Du diable), ne vois-tu pas ces fleurs pâles qui s'élèvent entre deux pointes de rocher ?
— Les veux-tu ?
Et, sans attendre sa réponse, se dépouillant de sa veste devant Madeleine interdite, il s'élançait dans l'eau et nageait vers la fleur.
Sans cesse repoussé par le courant, il fut obligé de s'y reprendre à trois fois. Il parvint enfin à arracher la plante, non sans peine, et l'élevant au-dessus de sa tête, il regagna le bord en nageant d'un seul bras.
— Oh ! merci, mon ami, lui dit Madeleine avec un sourire plein de bonté. Mais comment te remercier?
— En m'aimant bien.
— C'est pas difficile, répondit Madeleine, c'est déjà fait.
— Mais va donc, disais-je en moi-même, en feignant de lancer mon razal (Filet pour la pêche, garni à son extrémité de balles en plomb qui l'entraînent au fond de l'eau). Elle te met sur la route.
— Veux-tu de moi pour mari? lui demanda François d'une voix tremblante d'émotion ; car je t'aime... d'amour.
En lui disant ce dernier mot, qu'il avait prononcé tout bas, il l'attira à lui et la serra énergiquement dans ses bras.
- Ô François ! murmurait faiblement Madeleine défaillante sous l'ardent baiser du jeune homme, je ne veux que toi, et sans toi je ne peux vivre.
— Hum ! hum ! faisais-je en toussant. Je trouvai que ma leçon avait porté ses fruits, et je m'étais retourné de leur côté en riant.
Rouges et confus tous les deux, ils s'étaient écartés de nouveau comme s'ils avaient commis une grande faute.
— Je vous conseille de vous cacher et d'avoir des remords, leur dis-je en riant; per un poutet ! (Pour un baiser) Il est huit heures; allons manger la soupe, et qu'on soit heureux et san bergougno (Sans fausse honte). Vous savez maintenant à quoi vous en tenir.
Le jour baissait ; une petite brise courait dans les arbres, faisant frémir les peupliers et gémir les vieux saules; à peine si on entendait dans le lointain un vieux refrain chanté par quelque pâtre dans la montagne et les aboiements des chiens rassemblant le troupeau.
C'était bien l'heure des confidences pour deux amants qui venaient de se faire le premier aveu ; aussi, la main passée autour de la taille de Madeleine, François tout en marchant lui parlait à voix basse, et ma cousine répondait par des mots entrecoupés.
Il y avait encore une bonne heure de chemin avant d'arriver au village.
La lune venait de se lever par-dessus l'ombre noire que projette au loin la forêt des Fanges (Forêt impériale qui commence dans le département de l'Aude et finit dans les Pyrénées-Orientales, du côté de Caudiès).
A demi-heure du village, les deux amants s'arrêtèrent ; j'attendis à distance, mais je ne perdais pas un mot de leur conversation.
— Tu me le jures, disait François d'un ton solennel ; si le malheur veut que je parte, tu ne m'oublieras pas, tu m'aimeras toujours...
— Je te le jure.
Ma cousine élevait la main.
— Je suis à toi pour la vie. Par le Dieu qui nous éclaire en ce moment, je te fais ce serment !
La lune, qui brillait alors de tout son éclat, éclairait les traits des deux acteurs de cette scène, et leur donnait un air de sincérité qui ajoutait encore à leur beauté naturelle.
- Prends la moitié de ce bouquet, dit Madeleine en partageant les fleurs qu'elle tenait de François. Tu me le donneras le jour de la noce : espérons que ce sera bientôt.
— Dieu me protégera, répondit François ; je ne partirai pas.
— Quand tires-tu au sort ?
— Dans huit mois.
La pauvre fille trembla de tous ses membres.
— Oh! je prierai bien Dieu et Notre-Dame-de-Marseille (Dévotion aux environs de Limoux), reprit-elle avec confiance, et ils m'exauceront.
Ils reprirent leur marche, et recommencèrent à faire des projets en vue de leur futur établissement. Enfin nous atteignîmes le village.
— A demain, dit François doucement en embrassant sa promise.
— A demain, répondit Madeleine en lui prenant la main.
— Si vous vous reposiez un peu, dis-je à Martin en l'interrompant.
— Aussi bien vous demanderai-je encore à boire, répondit le conteur. Mon histoire n'est pas encore finie, et un peu de vin me rafraîchira le palais.
Je lui passai ma gourde, et il but une gorgée à la régalade.
11 reprit tout aussitôt son récit.
Les huit mois qui séparaient François de la conscription furent bien vite écoulés. Le temps passe vite quand on aime, et c'étaient toujours tes mêmes redites, les mêmes propos d'amour, les mêmes rêves de bonheur. La guerre avec la Russie venait d'éclater, et on disait qu'on appellerait sous les drapeaux tout le contingent de la classe de 1854.
A cette nouvelle, qui fit l'effet d'un glas funèbre sur la pauvre Madeleine, elle pâlit affreusement, et me défendit d'en parler à François.
— Qu'il ne le sache pas, me dit-elle; je veux qu'il aille tirer le sort avec confiance.
Dans quinze jours, tout au plus, nous devions savoir si François serait soldat.
Madeleine alla trouver M. le curé.
— Voilà 5 fr. que j'ai ramassés, M. le curé, lui dit-elle; vous voudrez bien me dire quelques messes pour que François ne parte pas.
En disant ces mots, elle fondit en larmes.
— Consolez-vous, mon enfant, lui répondit M. le curé, et reprenez votre argent ; je prierai pour vous, Dieu vous exaucera, et il ne vous séparera pas de celui que vous aimez avec tant de candeur. Sous peu de jours, espérons-le, je bénirai votre mariage.
Cet espoir, exprimé par M. le curé de cette voix qu'il sait rendre si douce quand il parle aux malheureux, cet espoir avait apporté un peu de calme dans l'esprit de Madeleine.
Elle vint, le soir, me trouver presque contente.
— Martin, j'ai confiance ; tu verras que François sera heureux.
Je ne voulais pas la détromper ; quelque chose me disait que la chance serait contraire. Enfin le grand jour arriva.
François, sombre et préoccupé, comme si un pressentiment funeste l'agitait, vint me chercher dès l'aube avec les cinq jeunes gens du village que la conscription réclamait : comme fils de veuve, j'étais exempt de droit.
Nous partîmes pour la ville, en promettant à Madeleine que je m'avancerais le premier pour lui apporter la nouvelle.
Le temps était affreux ; la neige tombait à gros flocons, et la courageuse fille voulut nous accompagner jusqu'à la moitié du chemin.
- Je t'attendrai ici, me dit-elle. Et s'adossant contre un rocher en saillie qui la protégeait un peu contre la bise, malgré nos prières, elle ne voulut pas venir au village.
A peine arrivés à Quillan, nous fûmes des premiers appelés avec la junesso (Les jeunes gens) de Belviane.
En s'approchant de l'urne, François tremblait de tous ses membres, et c'est à peine s'il avait la force de tendre le billet pour le remettre à M. le maire.
— Numéro 6, cria l'employé à l'état civil.
Les genoux de François se dérobèrent sous lui. J'accourus pour le soutenir, il était blanc comme votre chemise.
— Vous ferez un beau grenadier, jeune homme, lui dit le maire en forme de consolation.
— Un beau grenadier, répéta après lui l'employé avec une grosse voix et en riant comme un niais.
Je l'aurais assommé, tant je trouvais le mot hors de propos ; mais ce n'était ni le lieu ni le moment.
J'emmenai François à l'auberge rejoindre deux de ses compagnons d'infortune, et je leur conseillai de le faire boire un peu pour l'étourdir.
Mais il ne voulut rien, et la tête dans ses mains, il se mit à rêver tristement.
Je partis immédiatement, car je n'avais pas oublié ma pauvre cousine; du plus loin qu'elle m'aperçut, elle m'interrogea du geste et du regard.
La tête basse et l'œil morne, j'avançais comme un condamné à mort qui n'est pas pressé d'arriver au lieu de son supplice.
- Eh bien ! me cria-t-elle quand je ne fus plus qu'à quelques pas.
Je préférai lui faire mal tout d'un coup que de prolonger son inquiétude.
— N° 6, lui répondis-je avec des larmes dans la voix.
Elle devint verte; ses dents claquèrent et elle s'affaissa sur la neige, inanimée et raide comme une morte. Un moment, je crus qu'elle avait rendu l'âme; mais son cœur battait encore. A certains intervalles, son corps était agité par un tremblement nerveux. Je l'enveloppai dans ma roulière, et la prenant dans mes bras, je la portai jusqu'au village, où la nouvelle se répandit bientôt.
François était aimé de tout le monde; son caractère doux et obligeant lui avait fait beaucoup d'amis. On le plaignit, on s'apitoya sur Madeleine; la marâtre seule ne prononça pas une parole, quand, déposant Madeleine sur son lit, je la priai de lui donner ses soins. Un sourire joyeux s'était dessiné sur sa figure anguleuse, et, à partir de ce moment, je me méfiai de cette femme et je me promis de la surveiller.
La crise nerveuse fit place au délire.
— François ! criait Madeleine en me prenant pour son galant et en fixant sur moi ses yeux hagards et brillants de fièvre. Tu ne partiras pas, je ne le veux pas, je te le défends !
Je passe rapidement sur cette scène de désolation. Le curé vint le lendemain, et il réussit à ramener un peu de calme dans ce pauvre cœur endolori. Ma cousine prit son courage à deux mains, et n'attendant plus rien des hommes, elle priait Dieu avec ferveur pour éloigner tout danger de celui qui était la moitié d'elle-même.
J'allais de l'un à l'autre.
— Je me ferai tuer, disait François.
— Je serai morte avant son retour, ajoutait Madeleine.
J'employais alors le langage de la raison, et je réussissais quelquefois à faire luire à leurs yeux l'espoir de jours meilleurs et de leur réunion prochaine, si la paix venait à se faire.
Il fallut partir. Deux jours avant, ma cousine vint me trouver.
— Martin, me dit-elle, on assure qu'il fait bien froid dans le pays où François va se battre. Voilà six paires de bas de laine; tu lui diras que c'est toi qui les lui donnes. Je le connais, il ne les voudrait pas.
Elle s'était arrêtée; l'émotion l'étouffait.
— Puis, ajouta-t-elle avec embarras, tu lui remettras cette bourse en cuir ; il y a 20 fr. dedans.
— Moi, j'en mettrai 10 de plus, ça fera 30, répondis-je enthousiasmé de son dévouement ; car voyez-vous, monsieur, pour qui connaît notre pays, 20 fr. c'est une forte somme.
— Qu'il ne le sache pas au moins, me fit-elle en me menaçant du doigt ; si je l'apprends, nous nous brouillerons.
La pauvre fille me donnait ses épargnes de deux ans ; je lui promis d'être discret : François ne l'a su qu'à son retour.
Le surlendemain, tout le village était sur la route. Les adieux furent déchirants. Le père de François, ancien soldat du premier empire, voulut l'accompagner jusqu'à Quillan.
- Sers celui-ci comme j'ai servi l'autre, lui disait-il, et marche au feu comme un troupier fini. On n'en meurt pas ; j'en suis bien revenu, moi.
Sur le seuil de la porte, la vieille mère s'attacha au cou de son fils, et nous avions toutes les peines du monde à l'en détacher.
François donnait le bras à Madeleine. La brave fille avait retrouvé tout son courage. Pâle, mais résolue, elle affectait de la fermeté pour ne pas attendrir son amant.
Celui-ci-se retournait encore une fois pour revoir sa mère, et la pauvre vieille femme, épuisée d'émotions, allait de nouveau serrer son fils dans ses bras.
— Assez de criailleries comme ça, la femme ! s'écria le père Domerc ; partons du pied gauche, en avant, marche !
— Nous parlerons de lui, ma mère, lui cria Madeleine ; Martin nous lira ses lettres.
Le triste cortège s'ébranla.
Le père de François, en tête, agitait sa béquille d'un air martial, pendant que de l'autre main il essuyait adroitement une larme qui coulait sur ses vieilles moustaches. Je suivais à quelques pas, et j'aurais voulu voir François déjà à Quillan : on ne résiste pas longtemps à de pareilles émotions.
Arrivés à la sortie du village, le pauvre garçon pressa trois fois Madeleine sur sa poitrine ; puis la prenant à l'écart : — Reconnais-tu ces fleurs? lui dit-il en sortant d'un petit sachet des feuilles desséchées. « Tu me les donneras le jour de ta noce, » m'as-tu dit, il y a bientôt huit mois. Elles sont sur mon cœur ; le plomb de l'ennemi les respectera.
— Les miennes y sont aussi, répondit ma cousine; quoi qu'il arrive, elles y sont pour la vie.
Après ce court entretien, il pressa la main de Madeleine, et sans retourner la tête, il rejoignit ses camarades en courant.
Toute la junesso les accompagnait : les filles pleuraient, les mères poussaient des cris à fendre l'âme. Seule, Madeleine, les yeux fixés sur son amant, s'était isolée de tout le monde, et debout sur une éminence, ses beaux cheveux en désordre, elle restait absorbée dans sa contemplation.
— Allons, mes amis, il faut entonner le chant des conscrits, dit le père Domerc ; ça tue le temps et ça fait emboîter le pas.
Et puis, d'une voix encore énergique, il avait commencé le premier couplet de ce chant si triste. L'écho de la montagne le renvoyait à ceux qui pleuraient, comme une plainte ou un regret. A chaque coude que dessinait la Pierre-Lys, nous voyions le mouchoir de ma cousine s'agiter en signe d'adieu.
Pendant dix minutes, on entendit nos chants ; et puis, quand nos voix n'arrivèrent à l'oreille de Madeleine que comme un son affaibli et lointain, alors ma cousine se mit à deux genoux, elle pria longtemps et se prit à pleurer.
Le soir de cette malheureuse journée on ne vit personne dans les rues du village, et les gémissements et les pleurs se mêlèrent toute la nuit aux rafales du vent qui s'engouffrait dans nos montagnes.
Dans les villages de la plaine, où le bien-être rend égoïste, dans vos villes, où vous avez, je crois, plus de connaissances que d'amis, le départ de quelques conscrits passe pour un évènement très-ordinaire.
Mais dans un hameau comme le nôtre, qui compte tout au plus 200 habitants, l'amitié est comme une plante qui pousse de longues racines : la misère nous rend égaux, et si nous n'avons rien à nous donner pour soulager notre infortune, le cœur est au moins de la partie, et c'est bien toujours quelque chose.
François écrivit du dépôt, et je vous laisse à penser avec quelle joie on accueillait ses lettres. C'était à la veillée et à la lueur du calél (Sorte de lampion composé de quatre mèches dont l'extrémité trempe dans l'huile) que la lecture se faisait.
- Anen, lettrut (Allons, toi qui sais lire), lis-nous un peu ça, me disait le père Domerc, J'étais toujours au milieu, tourné du côté de Madeleine, et ses yeux fixés sur les miens, elle attendait chacune de mes paroles, comme le laboureur la pluie pour les semailles. Madeleine me remerciait d'un regard, et en s'en allant elle me disait toujours : — Tu me la reliras demain.
La brave fille finissait par les réciter de mémoire.
Pendant cinq mois, François écrivit régulièrement, et sa dernière nous annonçait son départ pour la Crimée. Elle était plus longue que d'habitude et pleine de détails. Nous nous réunîmes chez son père. Elle était ainsi conçue :
« CHERS PARENTS,
» Ma santé est très-bonne, et je souhaite que la présente vous trouve de même. Deux compagnies vont partir, et je suis assez heureux pour faire partie de la 4me du 1er, qui est désignée avec la 3me du même bataillon. Nous sommes tous impatients de tanner la peau aux Russes, et nous avons peur que l'occasion ne se présente pas aussi vite qu'à l'Alma et à Inkerman, parce que le siège, à cause de l'hiver, demandera encore du temps. Mon capitaine m'a dit comme ça : « Domerc, tu es un bon soldat ; il est malheureux que tu n'aies pas de l'écriture ; sans cela, je t'aurais fait caporal. »
» Je vais à l'école, et je commence à savoir lire. Sans la guerre, j'aurais pu bientôt écrire à Madeleine et lui parler de ce qui nous intéresse touchant notre amour, et de la conséquence, quant au bon motif. Mais je pense toujours à elle, et Bigret le tambour, qui confectionne ma lettre, pourrait vous dire que je lui en casse la tête.
» Je vous envoie mon portrait colorié ; j'y suis en grande tenue, peint par un Parisien, qui nous attrape la ressemblance moyennant un paquet de tabac de cantine. Que Madeleine le regarde souvent ; le sien est gravé dans mon cœur, et le temps n'en effacera pas la couleur.
» Salut, mes bons parents, à l'avantage de vous revoir bientôt ; j'ai celui de vous saluer avec respect.
» Deux gros baisers à ma bonne Madeleine.
» Mes compliments à Martin.
» Votre bon fils, »
François DOMERC. »
- Oh ! comme c'est ça, s'écria le père Domerc en regardant le portrait.
- C'est vrai qu'il lui ressemble, ajouta Madeleine, qui l'aurait embrassé si elle eût été seule.
— Trait pour trait, fit la vieille mère toute joyeuse.
Franchement, je vous dirai, en confidence, qu'il lui ressemblait comme une asperge à un navet ; mais je ne voulais pas leur faire de la peine, et je fus de leur avis
— Voyez-vous, le gaillard, continua le père Domerc, comme il parle des Russes. Ah! si j'étais plus jeune !...
— Eh ben ! que ferais-tu ? Avec tes blessures, tu ne peux pas te tenir debout.
- Silence dans les rangs, la mère ! Il y a encore assez de force dans ce bras pour tenir un fusil.
— Mais s'il est blessé, dit Madeleine en gémissant.
— On n'en meurt pas, cria le père ; il te reviendra, ma fille. En attendant, prends le portrait, tu nous l'apporteras de temps à autre.
Peste! quelle tenue ! c'est ficelé, ajoutait-il en le regardant encore.
On se quitta en promettant de se revoir pour parler de lui, jusqu'à ce qu'une nouvelle lettre vînt nous donner de la patience.
Nous étions au mois de janvier 1855. Les journaux rapportaient que l'hiver était bien rude en Crimée; depuis deux mois nous n'avions plus de nouvelles, et Madeleine, en proie aux soucis, pâlissait à vue d'œil et perdait le sommeil.
D'un autre côté, la misère sévissait plus que jamais dans le village.
Les vivres étaient bien chers et le pain devenait rare. Ma vieille mère était malade depuis un mois, et ce que je gagnais suffisait à peine pour lui acheter des remèdes. J'étais bien triste, et la douleur de Madeleine achevait de me désoler.
Un soir, j'entrai chez elle ; ma cousine mettait les enfants au lit. Je trouvai la marâtre accroupie au coin de la cheminée sans feu. La tête dans ses mains, elle paraissait réfléchir. Quelques mèches de cheveux grisonnants s'échappaient de son bonnet de serge noire et lui donnaient l'air d'une sorcière.
— Ah! c'est toi, Martin, me dit-elle ; tu viens lui parler de son François. Ça la fera vivre : regarde.
Elle se leva et ouvrit la huche au pain.
— Depuis ce matin, elle est vide; l'homme ne m'envoie rien des mines ; il est malade depuis huit jours, et les enfants crient; ils ont faim !
— Je vais vous prendre un peu de millas, lui dis-je ; c'est tout ce que j'ai avec une miche de pain.
Je revins au bout de quelques minutes; elle en mangea avec avidité, en offrit à Madeleine, qui refusa, parce qu'elle était souffrante. Le reste fut porté aux enfants.
— Ça ne peut pas pourtant durer ainsi, me dit-elle en s'animant.
Madeleine venait de descendre.
— Est-ce que tu crois, lui dit-elle, que je te laisserai coiffer sainte Catherine ? Tu es jeune, poulido (Jolie), tu peux trouver un autre galant qui te fera porter de jolies robes et te donnera du plaisir.
- De jolies robes ! du plaisir! dis-je tout étonné. Dites donc, la mère, expliquez-vous, s'il vous plaît ; je ne comprends pas.
— Je me comprends, moi, répondit-elle d'un ton bourru.
Madeleine plaça son doigt sur les lèvres, et, derrière sa marâtre, elle me fit signe de me taire.
Je sortis inquiet et agité. Cette femme parlait d'une manière sinistre ; je ne pus fermer l'œil de la nuit.
Le lendemain, Madeleine était de bonne heure sur le seuil de ma porte.
- Pas de lettre ce matin ?
— Non, lui répondis-je.
Elle regarda tristement le ciel et remua la tête d'un air désespéré.
— Mais comme tu es belle avec tes ajustements du dimanche ! lui dis-je d'un air étonné.
Elle portait son jupon rayé, son corsage en drap marron et son joli bonnet de soie noir, garni d'une ruche en tulle de la même couleur.
Ainsi vêtue, elle ressemblait à une madone.
- Nous allons à la ville avec ma belle-mère, me répondit-elle.
- Et que faire ? bon Dieu !
- Vendre ce que j'ai filé pour faire de l'argent. Hier, elle a parlé longtemps avec une grosse femme qui est venue dans l'après-dînée. Je filais dans ma chambre en pensant au pauvre François, et j'ai écouté leur conversation. C'est bien mal, mais c'est la première fois que ça m'arrive.
- Continue, lui dis-je avec impatience.
- Alors il est arrivé à mes oreilles des choses que je n'ai pas comprises. On parlait d'un MONSIEUR qui me voulait du bien ; puis, cette femme a fait voir de l'argent à la marâtre, et elle lui a dit qu'elle l'attendait aujourd'hui.
L'indignation me montait avec le sang à la figure. J'avais peur de comprendre.
— Et tu iras?
— Elle le veut ; tu le sais, elle me battrait.
— Elle pourrait bien pourtant aller toute seule à la ville. Qui soignera les enfants ?
- C'est ce que je lui disais, et je ne comprends rien à son insistance pour m'emmener avec elle. Viens-y, Martin; je ne sais pas, mais j'ai peur !
La pauvre fille se serrait contre moi comme pour me demander ma protection.
- J'irai, ne crains rien; je ne serai pas loin de toi.
Ma mère était bien tracassée; j'allais perdre ma journée, et elle manquait de tout. Il fallait toute l'amitié que je portais à ma cousine pour me décider à ce sacrifice ; mais j'allais faire une bonne action ; Dieu ne pouvait que me bénir.
Je les suivis de loin, et j'arrivai en même temps qu'elles à Quillan.
Elles traversèrent toute la ville et entrèrent dans une petite rue malpropre. Madeleine regardait souvent derrière elle. Elle m'aperçut de loin.
— Je suis là, lui fis-je avec la tête.
Une petite porte s'ouvrit avec mystère. Je ne les vis plus.
J'avisai une lucarne qui donnait dans une salle basse où se passait la scène. La rue était déserte. Je me hissai à la force du poignet, je regardai, et j'attendis.
— Voilà qui est bien filé, dit la grosse femme d'une voix caressante, en regardant l'ouvrage de Madeleine.
- Nous serons d'accord pour le prix, répondit la marâtre, en lançant un regard d'intelligence à sa complice.
- J'ai ici précisément un MONSIEUR qui s'occupe beaucoup de ce commerce ; il en achète des quantités. Je vais le faire descendre, si vous voulez.
Ma cousine se prit à trembler.
— Le voici précisément.
Alors je vis entrer un homme d'une cinquantaine d'années, rabougri, malingre et mis avec recherche. Ses petits yeux gris se fixèrent sur Madeleine avec la fixité du regard de la vipère.
- Oh ! la jolie enfant! s'écria-t-il en donnant une petite tape sur la joue de la jeune fille.
— Vieux podagre ! murmurai-je.
Ma cousine s'était reculée de quelques pas.
- Quoi ! mignonne, avez-vous peur de moi ? dit-il d'un ton de reproche. Je veux faire votre bonheur, Madeleine.
Il essayait de la prendre par la taille. Ses mains tremblaient.
— Acceptez cela, continua-t-il ; et il agitait devant les yeux de la pauvre fille une bourse qui rendait un son argentin.
— Il y a 100 fr. dedans ! insinua-t-il d'une voix caressante.
Ma cousine prit la bourse et la foula sous ses pieds.
- Que tu es cruelle ! Va, je ne serai pas chiche envers toi, Madeleine chérie; je t'aime comme un fou, et s'il me fallait marcher sur le feu pour aller jusqu'à toi, j'y courrais gaîment les pieds nus.
Les deux femmes avaient disparu, et le vieux débauché s'avançait toujours vers Madeleine.
La pauvre petite s'était blottie dans un coin, et les yeux en feu, la tête haute, elle s'était armée des ciseaux qui pendaient à son clavier, et défiait du regard et du geste celui qui voulait la déshonorer.
Il est temps de nous montrer, pensais-je. D'un coup de pied j'avais fait voler la porte en éclats, et j'entrai furieux dans l'appartement.
- Misérable coquin, criai-je au MONSIEUR, en me précipitant sur lui.
D'une main je l'avais appliqué à la muraille, de l'autre, je lui étreignais le cou. Ses dents claquaient de terreur, ses yeux étaient injectés de sang.
Je l'étranglais.
Je craignis de l'avoir étouffé, et je le laissai aller. Son corps s'affaissa comme une masse inerte le long du mur.
Au bruit, les deux femmes étaient accourues.
— Tu la paieras cher celle-là, me dit la maîtresse de la maison.
— En voulez-vous autant ? répondis-je à la grosse femme, vous n'avez qu'à parler.
Je tendais mon bras dans sa direction. Elle voulut me prendre par la douceur.
- Veux-tu 50 fr., et tu t'en iras ? Le MONSIEUR te les donnera; il est si généreux.
A ces mots, la colère me reprit, et prenant la marâtre d'une main et la grosse femme de l'autre, je les jetai sur le vieux débauché, qui, tout en me traitant de rustre, réparait le désordre de sa toilette un peu chiffonnée par mes gourmades.
Ils tombèrent tous les trois pelotonnés, et je les entassai dans un coin comme le fumier que l'on retourne. Quel saut périlleux ! j'en ris encore.
Me souciant fort peu que les voisins accourussent à leurs cris, je disparus avec Madeleine, et nous étions bientôt dans la campagne.
— Il est bien entendu que tu ne reviens pas chez ta marâtre. Je vais écrire à ton père, et en attendant je vais te loger chez le père à François.
- Oh! tant mieux, me répondit-elle, en me pressant les mains qu'elle baisait dans sa reconnaissance. Comme ça, je pourrai coucher sous le même toit qu'il a habité.
En arrivant au village, je racontai l'histoire; on attendait la marâtre pour la huer; mais elle ne rentra que dans la nuit, et elle fit bien.
Ma cousine fut reçue à bras ouverts par la famille de son amant.
— Tu feras du fil avec ma femme, dit le père Domerc. Et puis quand il y en a pour deux, il y en a pour trois.
Cependant Madeleine changeait à vue d'œil. Le silence de François devenait inquiétant ; mais elle espérait toujours et luttait contre le désespoir.
L'hiver s'écoula dans ces alternatives. Enfin, par une belle journée d'avril, François écrivit. L'hiver avait été bien rude, disait-il, et il avait essayé de faire passer de ses nouvelles ; mais le tambour Bigret avait été blessé, et il lui avait été bien difficile de se procurer du papier et un nouveau secrétaire, car ils avaient eu de bien mauvais jours à traverser.
Il avait eu le bonheur de ne pas recevoir de blessure ; « et si, comme c'est probable, ajoutait-il en achevant sa lettre, l'assaut est donné à l'automne prochain, et que j'aie la chance qui m'a accompagné jusqu'à ce jour, il est probable que je serai l'année prochaine près de ma bonne Madeleine, car je veux demander un congé. »
Après cette lecture, tout le monde fut content à la maison ; Madeleine reprit un peu ses couleurs, le père Domerc sa gaîté, et la vieille mère recommença à parler plus que jamais du mariage de François avec ma cousine.
— Comme vous allez être heureux ! disait la vieille. Quand il sera revenu, comme vous allez vous aimer ! Oh! non, Dieu ne me fera pas mourir avant que j'aie bercé, torché, emmailloté et mangé de baisers un de ces petits chérubins du ciel, qui font tant de bruit et qu'on voit grandir comme de jeunes pins.
— Assez de bavardage, la femme, répondait le père Domerc; pas de projets; laisse-le revenir d'abord.
La pauvre vieille femme se taisait, poussait un soupir, et, pour se consoler, regardait sa future belle-fille qui tricotait une paire de bas pour son mari.
L'été allait finir. Vers la fin d'août, nous eûmes encore une lettre.
L'assaut allait être donné, pensait François, dans le courant de septembre, c'était l'opinion générale, et il était impatient, comme tous ses camarades, d'en finir avec les Russes.
- D'après le journal que m'a lu M. le curé, dit le père Domerc, il y aura des casquettes de reste. Mais c'est fini ; je ne crains plus rien pour François, il en réchappera.
— Tu es bien tranquille, toi, lui répondit sa femme.
— Parce que je sais ce qu'il en est, et que son régiment ayant été souvent de tranchée pendant l'hiver, on voudra envoyer des troupes fraîches.
— Peut-être, répondit Madeleine avec son bon sens habituel ; comme on sait maintenant ce qu'il peut faire, on voudra, au contraire, des troupes aguerries.
— Bah ! répondit le père, parions qu'il ne sera pas de l'assaut.
— Qu'en savez-vous? ajoutai-je. Tenez, ne parions pas pour des choses aussi sérieuses.
- Tu as raison, toi, Martin ; mais avec la vieille, me dit-il en désignant sa femme, il faut toujours discuter.
Il bourra sa pipe avec humeur, et en aspira la fumée, en la lançant en l'air, méthodiquement et en mesure.
M. le curé nous fit une longue lettre qui arrachait des larmes ; il recommandait à François de ne pas se prodiguer, de faire tout bonnement son devoir, si le sort désignait son régiment pour l'assaut, de penser qu'il avait une famille inquiète qui priait pour sa conservation, et que sa mort serait le coup de grâce pour celle qui ne vivait que par lui et pour lui.
J'allai la jeter à la ville, et nous attendîmes dans les transes.
Sébastopol fut pris ; et mieux que moi, monsieur, vous connaissez les détails de ce beau fait d'armes.
Ce qu'on rapportait de la lecture des journaux, nous donnait à tous chair de poule. Trois mois s'écoulèrent. Rien !
Un jour de décembre, je m'en souviendrai toujours, je m'étais levé soucieux et avec un poids sur l'estomac. J'allais partir pour conduire des radeaux jusques à Carcassonue. Il était sept heures. Je rencontrai le facteur.
— Où vas-tu ? me dit-il.
— Chez le père Domerc.
— J'y vais aussi, j'ai une grosse lettre pour lui.
— Hein? lui fis-je, avec une voix altérée.
— Je crois, me dit-il avec mystère, que c'est quelque chose de mauvais concernant François : il y a un cachet noir, et ça pèse beaucoup.
— Viens vite, lui dis-je. Au moins, pensai-je, que Madeleine n'y soit pas !
Ma cousine rangeait quelque chose dans la chambre.
- Sortez, criai-je au père Domerc.
Je pris la lettre en tremblant, je l'ouvris, et je lus.
C'était son extrait mortuaire ! . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Il y avait dans l'enveloppe une lettre de son capitaine. « Je l'ai vu tomber, disait-il ; il est mort en brave. Je perds un de mes meilleurs soldats. » Mais, chose singulière l'on n'avait pas retrouvé son corps.
Le pauvre vieillard chancela, il s'appuya sur moi, et d'une voix tremblante :
— Voilà qui m'achève, me dit-il. Comment l'annoncer à la femme, à cette pauvre Madeleine ?
Puis se reprenant :
— Ah! maudits Russiens, si j'avais vingt ans! Et sa figure, rouge de colère, exprimait une ardeur que son âge trahissait.
Nous rentrâmes à la maison après avoir résolu de l'annoncer avec ménagement à la pauvre mère et à ma cousine. Mais Madeleine avait entendu nos voix, et nous avait aperçus par la fenêtre.
- Il y a une lettre, dit-elle en descendant joyeuse l'escalier quatre à quatre.
— Non, lui répondis-je, je l'aurais déjà dit.
- Mais certainement, ajoutait le père Domerc d'un air contraint, nous te l'aurions déjà dit.
— Mais tu la tenais à la main, cria-t-elle avec force, je l'ai vue. Vous me trompez, François est blessé !
Nous gardions le silence.
— Il est mort!. Mais répondez. Mais répondez, continuait-elle en allant de moi au père de François.
Nos larmes répondaient pour nous. La mère avait déjà compris. Alors, quand ma cousine eut lu dans nos regards l'affreuse vérité, s'élançant d'un bond dans le village, elle courut droit au précipice qui borde la route, les traits bouleversés et les yeux sortant de l'orbite. Je courais derrière elle. Il était temps, elle était déjà à un mètre de l'abîme lorsque je réussis à la rejoindre. Sa force était doublée par la crise nerveuse qui l'agitait. Trois fois elle se déroba à mon étreinte, trois fois je réussis à la reprendre. J'en eus enfin raison, et aidé de quelques amis qui passaient par-là, nous la reconduisîmes à la maison.
Pendant deux mois elle resta folle. Puis, comme il est écrit qu'on ne doit pas mourir à la suite de pareilles épreuves, elle redevint calme, résignée, mais sombre et restant quelquefois huit jours sans proférer une parole.
La première fois qu'elle reprit sa place à la table de ses parents d'adoption, les larmes coulèrent avec abondance, et personne ne put manger.
On m'avait invité, car moi seul avais un peu d'ascendant sur Madeleine.
— Viens là-haut, mon bon Martin, me dit-elle après le souper, avec sa petite voix douce qui va droit au cœur.
Je la suivis.
- Vois-tu, me dit-elle, voilà les fleurs qu'il m'avait données. Je les ai mises au-dessus de son portrait. Là, tous les soirs je prie, et je demande à Dieu qu'il me prenne bientôt pour aller le rejoindre au ciel.
— Allons, Madeleine, du calme, lui disais-je, tu fais du mal aux anciens. Sois plus forte que la douleur.
- Ah ! c'est facile à dire ; tu n'as jamais aimé, toi !
A cela je n'avais rien à répondre et je baissais la tête, car je comprenais l'étendue de ses regrets.
Peu à peu cependant la douleur fit place à la mélancolie. La pauvre fille se tournait vers Dieu, et M. le curé entreprenait de guérir les plaies du cœur, en prêchant la soumission aux décrets de la Providence.
Nous étions au mois de mai 1856.
La nature avait revêtu sa parure de fête. Partout de la verdure, partout des fleurs qui naissaient à la vie. Il était sept heures du soir. L'air était plein de tièdes senteurs ; les oiseaux célébraient par leurs chants la fin d'une belle journée, et les grillons dans les blés jaunissants mêlaient leur cri-cri joyeux aux coassements mélancoliques de la rainette dans les jonquiers.
A ces calmes heures des nuits sereines, on se prend facilement a rêver, et l'imagination, revenant vers le passé, réveille les vieux souvenirs et recompose dans le cœur les traits de ceux qui ne sont plus.
Ainsi faisait Madeleine ce soir-là ; et, assis à côté d'elle devant la porte du père Domerc, je pensais au pauvre François, en respectant le silence de ma cousine.
L'angélus sonna la prière. Elle se mit à deux genoux, et Dieu seul sait pour qui elle pria.
Pendant qu'elle remplissait ce pieux devoir, je vis venir à moi deux hommes conduits par un enfant du village qui semblait leur indiquer la maison. Ils approchaient lentement, car l'un d'eux marchait avec peine et semblait s'appuyer sur le bras de son camarade.
C'étaient deux soldats en congé.
— C'est ici, chez le père Domerc, dit l'enfant.
— Merci, gamin, répondit celui qui soutenait l'autre.
— Ohé ! père, criai-je, on vous demande.
Madeleine regardait étonnée.
— Qu'est-ce qu'il y a ? On y va, on y va.
Le bonhomme allait se coucher.
— Des soldats chez moi, ajouta-t-il avec satisfaction ; entrez, mes amis, et soyez les bienvenus.
- Bonsoir la compagnie, fit celui qui était valide, en saluant tout le monde; car nous étions entrés à leur suite.
— Pour lors, mon ancien, continua-t-il en s'adressant au père Domerc, voici la chose. Je suis de Caudiès, et mon camarade aussi.
Comme l'étape sera longue demain, nous avons profité de l'occasion d'un roulier qui nous a portés au-delà de Belviane ; il se trouve que mon camarade est très-fatigué, à cause de ses blessures, et que nous étions des intimes du pauvre François, votre fils.
— Vous l'avez connu ! s'écria vivement le père Domerc troublé.
Madeleine ne perdait pas une parole.
— Minute, ne m'interrompez pas, mon ancien. Nous avons demandé au roulier : Ousque c'est Saint-Martin-Lys? Il nous a indiqué notre route. Alors nous avons dit : Faut aller voir le père à François ; nous lui parlerons de son fils, nous casserons une croûte, et après avoir bien dormi, nous aurons moins de chemin à faire demain, et le camarade s'en trouvera mieux.
Le blessé baissait la tête. L'obscurité qui régnait dans l'appartement m'empêchait de distinguer ses traits, mais je l'avais vu tressaillir à plusieurs reprises.
— Vite, la femme ! vite, Madeleine ! Procurez-vous des œufs, faites une bonne soupe d'ail, donnez du bon fromage. Nous ne sommes pas riches, mes amis, mais c'est offert de bon cœur.
— Je vais chercher une bouteille de vin chez M. le curé ; il me la donnera.
J'étais bien vite de retour. J'en rapportais deux.
Madeleine alluma le calél.
Les deux femmes préparaient le souper. Le blessé, la tête basse, n'avait pas encore prononcé une parole ; l'autre parlait toujours.
— C'était un bon soldat, mon fils, n'est-ce pas, jeune homme ?
— Il serait décoré maintenant.
— Ah ! quel guignon ! mon pauvre François, s'écriait le père Domerc.
— Mais votre camarade ne parle pas beaucoup, dis-je, comme frappé de ce silence obstiné.
— C'est pas étonnant, voyez-vous, il souffre beaucoup. Blessé a l'attaque du Grand-Redan, il a eu la figure comme labourée par des éclats d'obus; malgré ça, il se battait comme un lion. Il a reçu une grêle de balles dans sa capote, et, couvert de sang, il restait toujours au poste de l'honneur. Ma foi ! un coup de fusil dans les yeux et une balle qui lui a fracassé l'épaule l'ont mis hors de combat. Il est tombé à demi-mort ; il n'en valait pas mieux. Fait prisonnier, il vient d'être échangé à la paix, et il rentre chez lui aveugle et horriblement défiguré.
Ne le regardez pas ; il fait peur à voir.
— Pauvre garçon ! s'exclama Madeleine avec intérêt.
— Tonnerre, et il n'est pas décoré ! cria le père Domerc.
— Il l'attend tous les jours. Le général qui commandait notre division lui a promis de s'intéresser à lui, et comme c'est un bon celui-là, il tiendra parole.
— Mais ce qui lui donne du souci, ce n'est pas tant son infirmité et sa triste figure, c'est autre chose.
- Eh quoi donc? demandai-je intrigué ; il y a de quoi pourtant.
L'aveugle parut prêter alors une grande attention, et je l'entendis respirer avec force.
- Voici. Il a laissé au pays une promise qui est une perle de beauté.
Lui aussi faisait un joli soldat avant ses blessures. Il l'aime comme un fou ; mais il se demande si sa maîtresse voudra de lui pour mari, maintenant que le voilà si tristement accommodé.
— Si elle ne le veut plus, répondit ma cousine avec feu, c'est qu'elle ne l'a jamais aimé. Ah ! si mon François m'était revenu sans bras ni jambes, je n'aurais voulu que son cœur, moi, et je l'aurais aimé encore plus qu'autrefois, si c'est possible.
Madeleine, à ce souvenir, fondit en larmes et cacha sa tête dans ses mains.
A ces mots, l'aveugle tendit les bras vers Madeleine ; il voulut parler, la voix expira sur ses lèvres. Je le vis ouvrir sa capote et tenir sa main dans sa poitrine. Il se leva ; son camarade le conduisit vers ma cousine, et là, ému, oppressé, il se mit à deux genoux et offrit à Madeleine un bouquet de fleurs desséchées.
— Lui ! c'est lui ! mon François !
Et ma cousine, éperdue, couvrait de caresses et de baisers la figure, les mains, les cheveux de celui qui, pour elle, semblait revenir à la vie une seconde fois.
Le pauvre garçon s'était évanoui. L'émotion avait épuisé ses forces.
Ah! monsieur, un tigre aurait pleuré. Il fallait voir cette vieille mère soutenir la tête de son fils et baiser ses nobles cicatrices, le père Domerc danser de joie et retrouvant tout d'un coup la légèreté de sa jeunesse. On n'entendait que des cris, des pleurs, des éclats de joie, et au milieu de ce bruit, la voix de Madeleine qui appelait son amant et lui disait de lui parler. Enfin, nos soins le firent revenir à lui.
— Pardon d'avoir douté de toi, et merci pour tout le bonheur que tu me donnes, Madeleine bien-aimée. Je peux mourir maintenant.
— Non, tu vivras, et nous serons heureux, répondit ma cousine.
Les baisers recommencèrent encore. Tantôt c'était le père Domerc, tantôt la mère, tantôt Madeleine.
— Ça, voyons, ce n'est pas tout, dit le camarade de François. Dans ce monde, des reconnaissances pareilles retournent singulièrement l'estomac. Faut se substanter à table ! n'est-ce pas, l'ancien ?
— Oui, s'écria le père Domerc, à table, et vive la joie !
Le dîner fut d'une gaîté folle. François, assis à côté de Madeleine, l'écoutait parler avec recueillement, comme s'il recommençait une nouvelle existence, en entendant cette voix chérie.
Le malheureux ne voyait pas sa Madeleine, et une larme suivait cette pensée et roulait le long de ses joues creusées par le chagrin.
Quand Madeleine devinait sa peine, elle le serrait dans ses bras comme pour lui rappeler qu'elle était là à côté de lui, et que désormais aucun obstacle ne les empêcherait d'être réunis.
Bientôt, on choqua les verres. Le père Domerc fêtait le vin de M. le curé, et le camarade de François était toujours en avance.
— Dites donc, père Domerc, dit-il en le regardant, je parie que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne me connaissez pas ?
— Pour ça, non.
— C'est moi, Bigret, fit-il en se rengorgeant ; Bigret, tambour à la 4me du 1er, né natif de Poitiers. Je me suis dévoué à votre fils. Congédié définitivement, je me retire dans mes foilliers, mais j'ai voulu faire la conduite au camarade. C'est moi qui ais inventé la frime de Caudiès et toute la balançoire, à cette seule fin de vous annoncer la chose plus naturellement et d'épargner votre sensibilité.
— Vous êtes un brave garçon. Donnez-moi la main. Vous touchez celle d'un vieux de la vieille.
- Oh ! je le sais.
— Allons, Bigret, à la santé de l'empereur, tonnerre !
— Vive l'empereur! crièrent-ils tous les deux.
Toute la soirée fut employée par François et Madeleine à se raconter bien des choses, leurs douleurs, leurs angoisses et leurs plus secrètes pensées, alors qu'ils étaient séparés.
Le père Domerc racontait ses campagnes à Bigret. Il en était au passage de la Bérésina ; il avait déjà tué huit Russes, et il serait arrivé à la douzaine, quand minuit vint à sonner.
— Vieux, tu as trop bu, lui dit sa femme.
— C'est que j'en ai perdu l'habitude ; sans cela. D'ailleurs, silence dans les rangs, la femme ! J'ai fêté un beau jour.
Bigret lui prêta l'appui de son bras, et demi-heure après, tout le monde dormait dans cette maison, où naguère encore habitait la douleur.
Un mois n'était pas écoulé que François épousait Madeleine, et tout le village assistait à leur mariage, se réjouissant d'un bonheur qui leur était bien dû.
François vient d'être décoré. Réformé à cause de ses blessures, il a une pension de 600 fr. ; de plus, le père Domerc, comme ancien militaire de l'empire, touche aussi 150 fr. Cela donne à vivre à toute la famille.
— Sa fortune est faite à ce brave François, ajouta naïvement Martin, mais il n'est pas complètement heureux ; il ne peut pas voir Madeleine !
— Mais enfin, le mal n'est pas sans remède. Que dit le médecin ?
— Il espère pouvoir le guérir.
— J'irai le voir en repassant par Quillan, et je saurai à quoi m'en tenir ; car votre récit m'a touché, et le sort de ce jeune couple m'intéresse.
- Ça n'empêche pas, me dit Martin en clignant de l'œil, que, dans le même cas, une belle demoiselle de la ville n'aurait pas voulu d'un homme défiguré et aveugle.
Je n'osai pas répondre à Martin que de nos jours, chez nos belles dames, la crinoline tenait plus de place que le sentiment, et pourtant, je l'avoue à ma honte, cette réponse se présenta tout d'abord à mon esprit.
Je me contentai de sourire.
— Adieu, Martin, lui dis-je en lui pressant la main. Merci pour votre bonne histoire ; vous êtes un digne et honnête garçon. Nous nous reverrons l'année prochaine.
— Qu'elle passe vite alors, et que Dieu vous accompagne !
De retour à Quillan, je voulus voir le docteur qui soignait le pauvre François.
— La rétine, me dit-il, n'a pas été atteinte. Il s'agit d'opérer une révulsion sur le nerf optique, à l'aide de moxas ou d'exutoires. Selon moi, la guérison est probable : c'est ma conviction.
— Si votre espoir se réalise, M. le docteur, écrivez-moi cette bonne nouvelle.
— Je vous le promets, me répondit-il.
J'écrivis à Martin pour lui transmettre l'opinion du docteur et faire prendre patience au malheureux, aveugle.
Deux mois après, j'ai reçu la nouvelle de sa guérison.
Alors j'ai pensé à la joie de François et de Madeleine ; et, au milieu des ambitions mesquines de la ville, des aspirations bruyantes de la foule à la fortune et aux honneurs, j'ai vu par le souvenir passer devant mes yeux charmés ces deux pauvres villageois, types accomplis de dévouement dans le malheur, de grâce ingénue dans l'amour.
J'ai voulu leur consacrer quelques lignes.
Il fallait écrire avec le cœur. Peut-être avais-je trop présumé de mes forces ; le lecteur sera indulgent, car si l'intention de l'apitoyer sur leurs infortunes est une excuse suffisante, il comprendra ma témérité, et d'avance je me crois absous.
Henri VIÉ-ANDIZE.
Narbonne, 18 novembre 1857.