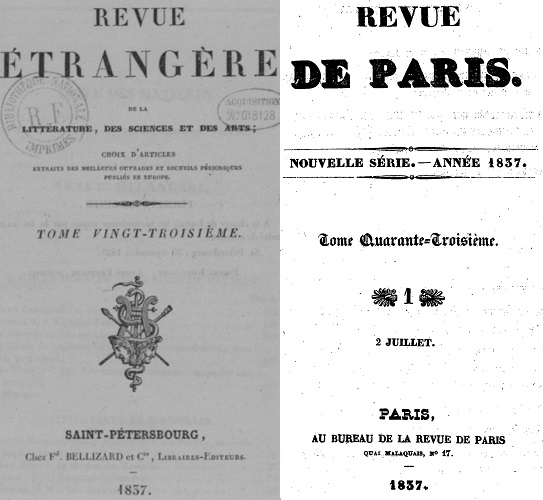
Revues éditant la nouvelle de J.P. Lugan (Source gallica.bnf.fr)
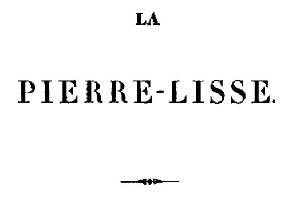
En remontant la rivière de l'Aude, au-dessus de Quillan après avoir parcouru dans leurs capricieux détours les paisibles vallées qu'elle arrose, où mûrissent hâtivement d'excellents fruits abrités du vent du nord; après avoir joui du spectacle de tant de jolis sites, de la forge de Quillan et de sa verte montagne, du laminoir avec ses hautes cheminées en feu, du château pittoresque de Belviane, le regard, accoutumé aux découvertes lointaines de ces charmants paysages, vient se briser tout à coup contre un mur de rochers que rien ne faisait pressentir, rempart immense, couronné de sapins séculaires qui, ressemblant à de longues piques, atteignent et déchirent les nuages. Tel est du moins l'aspect qu'offrent les montagnes des Fanges et de Quirbajou, lorsqu'à la sortie de Belviane elles paraissent mêler leurs forêts et ne faire qu'une même masse de pierre, du sein de laquelle s'élance la rivière en bouillonnant. Ce n'est qu'en arrivant au pied de ces montagnes à pic qu'on voit entre elles une large crevasse, par où passe l'Aude.
L'entrée de cette gorge est d'un effet admirable. A une grandeur sauvage elle joint le caractère des monuments gothiques. Des rochers blancs s'élancent en aiguilles; d'énormes blocs aux angles vifs et dentelés, qu'on prendrait pour des tours carrées couronnées de créneaux, commandent le passage. Vous marchez quelques pas sur un chemin étroit, mais solidement construit, sur la rive gauche de la rivière, et vous arrivez à la porte de la Pierre-Lisse, percée dans le roc. Dès que vous en avez franchi le seuil vous vous sentez accablé par la majesté du lieu qui de toutes parts vous enserre. Le regard plonge en avant dans les sombres profondeurs de la gorge; sur les côtés s'élèvent des escarpements gigantesques aux parois lisses et noires où le plus petit arbuste n'a pu prendre racine, et sur les bords desquels vous apercevez confusément suspendus des débris de rochers; mais un ciel pur parait au-dessus de votre tête, et si le soleil éclaire ces roches brisées, vous croyez voir des châteaux d'or d'une structure bizarre qui se projetent sur l'azur. Le passage a trois quarts de lieue de long, et à chaque pas on rencontre un objet qui frappe d'étonnement. C'est un torrent qui sort de la montagne de droite, tombe en hurlant dans un gouffre, passe sous vos pieds, et vient mêler ses eaux blanches d'écume aux eaux jaunâtres de l'Aude; ce sont des grottes ténébreuses, abîmes inconnus qui ont leur gueule béante sur un abîme, des rochers qui pendent sur la route pour la défendre de ceux qui roulent du haut de la montagne; puis l'Aude, qui tantôt passe rapide comme un trait, grondant au fond de la gorge étroite et profonde et tantôt s'épanche doucement de chute en chute comme une cascade. Vous étes enivré du bruit, de la solitude du désert, de la poudre des torrents que les vents engouffrés vous jettent au visage. L'imagination se perd au sein de cette nature sauvage et des vestiges des vieilles révolutions du globe. Vous croiriez que la terre tremble encore autour de vous de la secousse qui a soulevé les montagnes; mais l'aspect de la jolie route sur laquelle vous marchez, solide et pittoresquement attachée comme un balcon aux flancs de Quirbajou, vous rassure. Elle fuit un instant et s'échappe dans les sinuosités du détroit; puis bientôt elle reparaît au loin comme un ami qui marche devant vous, et vous guide au milieu des précipices.
Le génie et la puissance de l'homme se révèlent là d'une manière éclatante. Ce passage semblait lui être interdit, et il le traverse d'un pas ferme et sans crainte. Mais ce n'est point un sentiment d'orgueil qui doit exalter l'âme à la vue de cette route; ce n'est point la vanité qui a présidé à sa construction, c'est la plus pure charité d'un prêtre, du curé d'un pauvre village situé à la sortie de la gorge, dans une vallée triste et stérile, où il était enfoui et séparé du monde. Au milieu des sublimes beautés qui remplissent la Pierre-Lisse, cette simple route, monument de la vertu d'un prêtre, me paraît encore la plus sublime. En sortant de la gorge, j'aperçus le village de Saint-Martin, pour lequel le chemin que je venais de parcourir, avait été construit. J'arrivai au village, et je m'y arrêtai un moment. Le bon curé était mort; il reposait humblement dans un coin du cimetière. La pierre qui le couvrait ne portait pas même son nom; mais ce nom était profondément gravé dans le coeur des habitants. Je l'avais entendu prononcer avec amour et respect par tous ceux que j'avais interrogés depuis Quillan. Je ne vis que des femmes dans les rues de Saint-Martin et je fus touché de l'expression de tristesse et de douceur, peinte dans leurs grands yeux, qui ressortaient singulièrement sur leurs visages noircis par le charbon. Ce ne fut qu'à grand'peine que je trouvai un guide en l'absence de tous les hommes du village, occupés à faire du charbon dans la forêt des Fanges. Cependant, grâce à la complaisance et à l'honnéteté de l'aubergiste chez, lequel je m'étais arrêté, je parvins à m'en procurer un, et je partis avec lui pour Gincla. Comme je me plaignais qu'il me conduisît par un étroit sentier, où mon cheval butait, à chaque pas « Mon Dieu, me dit-il, il n'y a pas d'autre route. Ah! si notre curé vivait encore, tout cela serait changé! Des hommes comme celui-là ne devraient pas mourir. Avez-vous entendu parler de notre curé ? » Moi, qui ne me lassais pas d'ouïr l'éloge du saint homme, je ne demandai pas mieux que d'engager mon guide dans le sujet de conversation qu'il ouvrait, et j'oubliai, en l'écoutant, le mauvais chemin. Il me dit d'abord ce que je savais déjà; mais sa naïve admiration était si vraie, ses paroies partaient si bien du fond de l'ame, où était vivante l'image de son curé, que j'éprouvai un inexprimable plaisir à l'entendre me répéter dix fois la même chose. Il y avait dans ce qu'il me disait un mélange de fierté et d'émotion profonde. Le curé était la gloire du pays ; mon guide en parlait d'abord avec enthousiasme, avec une sorte d'orgueil, et bientôt avec attendrissement. Il me fit connaître d'ailleurs, mieux que tous ceux qui m'avaient donné des renseignemens sur le chemin de la Pierre-Lisse, toutes les circonstances de sa construction, et il mêla à son récit l'histoire d'une jeune femme de Saint-Martin qui m'intéressa, vivement. Cette touchante histoire résumait pour moi la vie forte des populations montagnardes, cette vie de travail et de paix, de peines et de consolations. Nous parcourions une vallée terne et stérile, ensevelie sans cesse dans les ombres des montagnes; eh bien! en écoutant le récit des vertus du curé et de la pauvre femme, il me semblait qu'une douce clarté se répandait dans la vallée, qu'un parfum s'exhalait du sein de la terre. Un moment le pays ne me parut pas aussi stérile que je l'avais cru d'abord. L'air était doux et serein, un vent frais balayait du ciel quelques légers nuages; des faisceaux de rayons du soleil couchant s'échappaient entre deux montagnes, et éclairaient trois ou quatre maisons éparses sur le penchant d'une colline, entourées d'arbres; des fleurs écloses entre les fentes des rochers se balançaient aux brises du soir. Ce tableau riant fut pour moi comme l'image du bonheur qui m'apparaissait par lueurs dans l'existence des habitants de ces montagnes; et dès-lors je ne trouvai, plus-cette vie aussi triste et aussi obscure. Arrivé à Gincla, je voulus me rappeler ce que m'avait raconté mon guide, et voici ce que j'écrivis.
Le village de Saint-Martin, bati sur les bords de l'Aude, fait, de loin, l'effet d'un amas de roches calcinées qui auraient roulé de la montagne des Fanges; sa population entière est composée de charbonniers; et, avant qu'un chemin fût pratiqué dans la Pierre-Lisse les femmes de Saint-Martin étaient obligées de franchir la haute montagne de Quirbajou pour aller vendre du charbon et du bois à Quillan, et y faire leurs provisions; car le sol ingrat qui entoure le village ne peut rien produire de ce qui est nécessaire à la subsistance des habitants; il n'y a pas un seul morceau de terre où l'on puisse gratter et semer. Que dans la belle saison ces pauvres femmes fussent condamnées à gravir la montagne deux ou trois fois par jour, cela n'était que pénible pour elles; le travail est la loi de l'humanité et le pauvre est habitué à arroser son pain de sa sueur. Mais, dans l'hiver, lorsque la montagne était couverte de neige lorsque le vent glacè du nord soufflait à déraciner les sapins, qui n'aurait plaint cette malheureuse population forcée, par la faim, de quitter le toit où s'abritait son indigence; d'affronter la tempête, les frimas et les mille dangers dont était semé le chemin de la montagne? La vie, dans ce triste village, n'était pas supportable; la misère et le désespoir y étaient à leur comble, quand le curé Armand vint porter quelque soulagement à la dértresse des habitants. ll ne leur donna pas de l'or, il n'en avait pas; mais il leurdonna sa vie. Pour les rendre moins misérables, il chercha à les rendre meilleurs; et il sut leur inspirer cet esprit d'ordre et de prévoyance qui féconde le travail. Telles furent les merveilles de sa charité, les heureux effets de ses bons conseils et de son exemple, que bientôt l'hiver, si redouté des habitants de Saint-Martin, se passa en attendant patiemment la saison des travaux, dans la paix et la consolation. Le curé Armand fut la providence non-seulement de ce village, mais encore de tout le pays. Son presbytère était connu à dix lieues à la ronde; et les pauvres, descendant en foule des montagnes, venaient, à, certains jours, s'asseoir sur le seuil de sa porte. Sa charité était inépuisable ; mais elle ne se répandit pas sur des ingrats.
Parmi les jeunes filles de Saint-Martin, il y en avait une nommée Catherine, qui, à seize ans, douée d'une beauté remarquable, était un modèle de patience, de modestie et de douceur. Elle n'avait qu'une, mère infirme, dont la maison délabrée touchait le presbytère. Le curé l'avait toujours chérie entre toutes, d'abord à cause de son indigence, plus tard pour ses vertus. L'enfant avait grandi sous ses yeux, et presque avec le lait de sa mère, elle avait reçu, par les soins du bon prêtre, le plus doux et le plus pur aliment de l'ame; aussi, était-elle devenue la plus aimable et la meilleure fille du pays. Dès qu'elle avait été assez forte pour aller au bois et traverser la montagne, elle avait nourri sa mère; l'aisance peu-à-peu était venue sourire au foyer de la pauvre infirme toujours triste et souffrante depuis la mort de son mari. C'est que Catherine ne craignait pas la peine; quelque temps qu'il fit, on la voyait, par la montagne, conduisant son ânesse chargée de charbon à la forge de Quillan, marchant toujours d'un même pas, vive et légère, le front riant d'innocence et de grâce. Elle ne s'arrêtait pas, comme faisaient ses compagnes, à jaser sur la route; si elle partait de Saint-Martin avec elles, elle était bientôt devant; et arrivait avant elles à la forge. Elle savait trouver, dans la journée, assez de temps pour faire trois voyages au lieu de deux que faisaient seulement les autres. On ne la voyait pas s'amuser aux doux propos des nombreux amoureux qu'elle rencontrait. Ses longs cils baissés, rougissant au moindre mot, elle s'échappait de leurs mains, ne riant avec eux, et ne leur répondant que de bien loin. « Marche! marche! lui disait une voix qui parlait dans son coeur, ta mère t'attend, et ses paroles sont plus douces à entendre. » Avec un soleil brûlant, par la pluie, le vent ou la neige, elle allait toujours; et, pour soutenir son courage: « Marche! marche ! lui criait encore son coeur, et tanière aura du pain. » Les charbonniers, qui savaient que tout ce qu'elle gagnait était pour sa mère, ne la faisaient jamais attendre à la forêt. Les forgeurs auraient eu du plaisir à la voir ; mais, sachant aussi pourquoi elle avait hâte de s'en aller, ils la retenaient le moins qu'ils pouvaient. Elle ne perdait pas un moment; il n'y avait pour elle ni repos ni cesse; à l'aube du jour, elle était sur la montagne, et le crépuscule du soir souvent l'y voyait encore; tous les jours que Dieu faisait, elle gagnait son salaire. Aussi sa mère ne manquait plus de rien; elle était même devenue riche, car alors il y avait toujours quelque chose à donner dans la maison. Catherine était citée pour la fille, non-seulement la plus jolie et la plus sage du pays, mais encore pour celle qui avait le meilleur coeur. Ceux qui auraient voulu trouver une tache à cette ame si pure lui reprochaient de trop courtes apparitions à l'église. Mais quelle longue prière eût valu l'œuvre de chaque jour? Cette éternelle pensée du bonheur de sa mère ne venait-elle pas d'un coeur plein de piété? Sa prière dans son sein était comme l'encens des fleurs qui s'exhale sans cesse de leurs calices; et Dieu, satisfait de cette suave offrande, suivit sans doute du regard la courageuse fille, lorsque, souffrant la chaleur ou le froid, elle traversait, solitaire, la rude montagne en pensant à sa mère. Quant au curé, il disait que Catherine était un ange de vertu et de piété, que le chemin du ciel pour elle était celui de la montagne. Combien de fois, se promenant sur les bords de l'Aude, et voyant de loin la bonne fille apparaître au haut de la côte, puis en descendre la pente rapide et glissante, il s'est arrêté à la regarder et à l'attendre les yeux pleins de larmes. Il commençait souvent par lui faire un tendre réproche. « Catherine, lui disait—il", tu travailles trop, il faut te réposer mon enfant; ta mère ne veut pas qu'avec le mauvais temps tu ailles à la forgé; on ne doit pas abuser de la force que Dieu nous a donnée. » Et s'il voyait ses mains rouges de froid : « Tu es une brave fille, lui disait-il en essuyant une larme. Tu as froid, pauvre enfant; va te réchauffer sur le sein de ta mère, et que la bénédiction du ciel descende sur vous deux. »
Catherine eût été un vrai trésor dans un ménage avec mari et enfants : c'était ce que tout le monde disait; aussi avait-elle un grand nombre de soupirants. Un jeune homme riche, de Belviane, en la voyant passer, en était devenu amoureux. II avait bien essayé d'abord de l'attendre sur la route et de l'arrêter pour lui parler, en riant, de son amour; mais il s'était bientôt aperçu que Catherine ne s'amusait guère à l'écouter, qu'elle devenait sérieuse et fière à la plus légère intention un peu douteuse, et que, fouettant impitoyablement son ânesse, elle partait, le laissant jeter au vent ses belles paroles. Il y avait dans toute sa personne quelque chose de si véritablement chaste, que le jeune homme sentit bien tôt un profond respect se mêler à son amour, et qu'éperdument épris de l'honnête et jolie fille, il la demanda en mariage. C'était un excellent parti pour elle, si bien que, malgré l'intérêt qu'on lui portait généralement, cette fortune inespérée excita l'envie. "Le curé approuvait fort ce mariage, heureux de voir la vertu de Catherine récompensée, car le prétendu n'était pas seulement riche, c'était un brave garçon. Mais Catherine n'était pas destinée au bonheur.
Il y avait, dans le voisinage, un jeune homme à peu près de son âge, qui l'aimait dès l'enfance comme un frère aime une soeur. Leur mutuelle affection avait presque commencé avec leur vie, et ce sentiment qui unissait leurs coeurs était si pur, qu'ils n'en connaissaient pas la nature, ne s'en rappelant pas l'origine; Ils avaient semblé, jusque-là, n'y voir tous les deux qu'une douce habitude de s'aimer. Mais lorsque le bruit du mariage de Catherine se répandit dans le pays, André, cet ami d'enfance, devint si chagrin, qu'il en tomba malade. Il ne jouissait pas d'une bonne santé; sa mère était morte poitrinaire, et sa vie avait donné plusieurs fois de vives inquiétudes. Cet état de faiblesse et de souffrance, qui dans les villages inspire une frayeur superstitieuse, une espèce d'éloignement pour ceux qui en sont frappés, comme ferait un signe de réprobation céleste, n'avait pas peu contribué, au contraire, à toucher le coeur de Catherine. La tendresse et la pitié qu'elle éprouvait pour lui n'avaient peut-être qu'une même source. André était seul à la maison; son père travaillait à la forêt; depuis plus de vingt-quatre heures le jeune homme n'était pas sorti. On l'ignorait dans le village, parce qu'on le croyait au charbon; mais rien n'avait échappé à la tendre sollicitude de Catherine. Le soir, lorsqu'elle revint de la forge, elle vit de la lumière qui sortait par une fente de la porte d'André. — Pauvre André ! pensa-t-elle, il est donc malade. Elle dit en entrant à sa mère, avec sa chaste candeur :
— André est resté enfermé tout le jour, sans doute il est souffrant ; il est seul; qui donc pourra le soigner ?
— Eh bien ! lui répondit sa mère, va voir, ma fille, s'il à besoin de nous.
Alors l'excellente créature, le coeur doucement agité,'traversa la rue et vint frapper à la porte d'André. Aucune voix ne répondit de l'intérieur; effrayée de ce silence, elle ouvrit la porté et entra.
La chambre était éclairée par la lueur du feu de la cheminée où flambaient quelques morceaux de bois. André, assis sur une chaise près du foyer, avait les coudes appuyés sur ses genoux, le front pâle et pensif, penché vers la flamme que ses yeux fixes regardaient tristement. C'était dans le mois de septembre, la soirée n'était pas froide; mais André se chauffait parce qu'il avait la fièvre. Tournant le dos à la porte, il ne vit pas entrer Catherine, et, profondément absorbé dans sa rêverie, il ne l'avait pas entendue. Catherine fit quelques pas vers lui, et d'une voix ému l'appela : — André ? — Cette voix le fit tressaillir sur sa chaise; il se redressa comme un homme éveillé en sursaut; il détourna vivement la tête, et, voyant Catherine qui s'avançait, il jeta du fond de sa poitrine un cri de joie et de surprise, qui retentit aussi bien avant dans le coeur de là jeune fille. Il fit un effort pour se lever, mais, soit émotion, soit faiblesse, il retomba éperdu sur sa chaise, les bras défaillants, les yeux levés vers Catherine, le visage empreint d'un indicible mélange de plaisir et de douleur. Elle s'approcha de lui, avec ce naïf abandon d'une soeur, sans baisser les yeux, sans rougir.
— André, lui dit-elle, si tu es malade, je te servirai.
Ces simples paroles pénétrèrent comme un trait dans le coeur d'André, et vinrent y toucher je ne sais quoi de tendre, d'où s'échappa une source de larmes. Il ne put proférer un seul mot; il prit la main de Catherine, la serra avec force et l'inonda de pleurs. Ils restèrent longtemps muets tous les deux. André pleurait, le front appuyé sur la main de la jeune fille, et Catherine, debout près de lui, lui abandonnant sa main, laissait aussi couler ses larmes en silence sur la tête de son ami. André les sentait tomber une à une avec bonheur.
— pourquoi, dit enfin Catherine, pourquoi es-tu triste depuis quelques jours? Pourquoi n'es-tu pas venu nous dire que tu étais malade? Tu sais bien que ma mère t'aime. Qu'as-tu, André ?
— Oh! rien à présent, rien, répondit le jeune homme en relevant la tête; Je suis heureux, puisque je te vois. Tiens, regarde j'essuie mes larmes. Cependant il dit cela avec un reste de tristesse. Il avait beau essuyer ses yeux, de grosses larmes reparaissaient toujours aux bords de ses paupières; ses regards interrogeaient avec inquiétude les regards de la jeune fille, et des soupirs qu'il ne pouvait étoufer sortaient de sa poitrine.
— Eh bien ! lui disait Catherine, si tu es content de me voir , pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne me souris-tu pas?
André essaya de sourire, mais son sourire mélancolique attristait encore la jeune fille.
— Allons, André, lui dit-elle, en laissant tomber sur lui un regard caressant, parle-moi; dis-moi ce que tu as sur le coeur.
Le visage d'André changea tout à coup. Un éclair de désespoir passa sur son front, son œil s'anima d'un feu sombre, et il dit d'un ton de voix déchirant :
— Oh! si cela est, Catherine, je n'ai pas besoin de ta pitié; laisse-moi mourir.
— Non, André, cela n'est pas, s'écria vivement la jeune fille, et avec tout l'élan de son ame, elle jeta les bras autour du cou de son ami et pressa sa tête contre son sein.
— Cela n'est pas, répéta André hors de lui, ressaisissant avidement l'espoir de son bonheur, cela n'est pas? Oh pardonne-moi Catherine. Mais expliquons-nous; m'as-tu bien compris? Une fausse joie, vois-tu me rendrait encore plus misérable.
Il l'éloigna un instant de son coeur, et contenant la joie prête à éclater sur son visage, prenant les deux bras de Catherine avec un frémissement passionné:
— Parle, lui dit-il d'une voix tremblante; est-il vrai que tu te maries avec M. Auguste de Belviane?
— Non.
— N'a-t-il pas demandé ta main?
— Je l'ai refusée.
— Pour qui donc?
— Pour toi.
Un cri de bonheur retentit dans la maison, André, dont tous les traits respiraient le délire de la joie, attira Catherine sur sa poitrine, et l'y retint dans un long embrassement, comme s'il avait voulu confondre leurs cœurs.
— Tu me veux donc moi, pauvre André? lui dit-t-it en baisant sa tête et ses vêtement avec ne sorte d'adoration. Mon Dieu, mon Dieu! pourquoi ne m'avez-vous pas fait riche? Oh Catheriue, ce n'est que pour toi que j'ai désiré la fortune pour vous rendre heureuses ta mère et toi. Combien de fois j'ai rêvé que je trouvais un trésor, et que je venais l'apporter à tes pied!... et tu m'as aimé sans cela, moi pauvre, faible, malade...
Catberine ne répondit qu'en le pressant doucement dans ses bras, et disant d'une voix attendrie :
— Cher André!
— Oh! Catherine, s'écria le jeune homme avec exaltation, tu m'as donné plus que ma mère, tu m'as donné une nouvelle vie. Avec toi je serai fort. Regarde un seul mot de toi m'a guéri.
André se leva, il était d'une grande taille, et son corps, en se redressant plus que de coutume, sembla encore grandi; son visage, doux et languissant, resplendit d'une beauté mâle, sa tête secoua ses grands cheveux noirs avec le sentiment d'une nouvelle puissance et à travers les longs cils de ses paupières brilla une flamme qui echauffa le cteur de Catherine. Ravie, elle le regarda cette fois avec toute l'ivresse de l'amour. André la saisit dans ses bras, l'enleva pour la baiser au front comme il eût enlevé un enfant. Ah que Catherine aimait à présent à sentir sa faiblesse, elle qui s'était toujours crue plus forte qu André !
— Oh oui puisque tu m'aimes, lui dit le jeune homme je sens que je vaux quelque chose; viens à présent, j'aurai du courage et de l'orgueil; viens, je vais te demander à ta mère.
Ils sortirent en se tenant par la main.
La mère de Catherine s'était bien aperçue dès leur enfance de leur attachement; mais elle avait toujours repoussé toute idée de mariage entre eux parce qu'André n'avait pas de santé. Cependant, ne voulant que ce que désirait sa fille elle renferma ses craintes dans son sein, et embrassa André comme son fils. L'heureux jeune homme était à ses pieds lui prodiguant toutes les expressions de tendresse que pouvait lui dicter sa reconnaissance et, voyant tout dans l'avenir aussi beau que celle qu'il aimait, il prédisait pour tous trois une éternité de bonheur.
— Mon Dieu! lui disait la vieille femme attendrie, je sais bien que ce n'est pas un bon coeur qui te manque.
— Oh! ni la force non plus, s'écria André en se levant, ne le craignez plus, ma mère, – et s'exaltant de nouveau avec cette pensée que l'amour de Catherine lui donnait une nouvelle vie: – Dieu a permis ce miracle, disait-il; vous le verrez; je ne veux plus qu'elle travaille; il est temps qu'elle se repose; je travaillerai pour vous deux.
— Oh! je sais bien, disait encore la vieille en hochant la tête, que si tu pouvais tout ce que tu désires, je sais qu'elle serait heureuse.
Elle le sera, répondit André avec un irrésistible accent de confiance, qui étonna la mère de Catherine; et comme il invoquait le nom de Dieu, elle espéra dans cette protection d'en haut, dont un rayon semblait briller sur le front du jeune homme.
Il fut arrêté que le mariage aurait lieu sous peu de jours, et André rentra heureux chez lui. Mais ce qu'il avait pris pour la force n'était que l'excitation de la fièvre; l'accès l'ayant quitté tout à coup, il se trouva d'une extrême faiblesse et il se mit au lit, en disant: - Mon Dieu m'avez-vous déjà abandonné? Cependant, délivré du poids douloureux qui l'oppressait depuis quelques jours, il reposa en paix. Avec la joie de l'ame, dans cette chambre encore pleine de la présence de Catherine, respirant l'air qu'elle avait respiré, il recouvra bientôt la santé. Ce mariage fit beaucoup parler dans le pays. Ceux qui voulaient réellement du bien à Catherine, ne l'approuvaient pas, parce qu'ils croyaient y voir un grand malheur pour elle. Le curé était de ce nombre; il lui fit d'abord quelques observations sages, mais connaissant l'amour vrai et pur des deux amants, dès que leur union parut une chose irrévocable, il partagea leur bonheur et bénit leur joie, mettant sa confiance pour l'avenir dans la Providence.
En moins de trois années, Catherine eut deux enfants. Le bonheur des deux époux ne fut pas un seul instant troublé; ils vécurent tout ce temps dans la douce possession d'eux-mêmes, d'amour, de travail et d'espoir; mais la quatrième année, ce qu'on avait craint arriva. La santé d'André s'altéra. Alors on vit entre eux une lutte touchante de dévouement. André dissimulait son mal ; mais Catherine, dont la vive tendresse veillait, tout en lui cachant ses inquiétudes, employait tous les moyens qu'elle pouvait imaginer pour empêcher d'aller travailler à la forêt. Lui, de son côté, voyant sa femme affaiblie par l'allaitement de ton dernier enfant, ne voulait pas lui permettre d'aller à la forge, et il s'échappait de la maison avant le jour, redoublant d'ardeur pour le travail. Mais ses forces secondaient mal sa volonté ; plusieurs fois on l'emporta évanoui de la forêt. Catherine voulait alors se servir, avec une sorte d'autorité, de l'ascendant qu'elle avait sur son mari pour le retenir au village ; de là de légères contestations dans lesquelles le curé intervenait toujours heureusement, car dès qu'il paraissait, la paix était faite. La querelle des époux finissait chaque fois par de saints embrassémens; leurs malheurs ne faisaient qu'accroître leur amour.
André fut bientôt forcé de se soumettre, et l'épuisement où il était l'obligea à s'aliter. Catherine eût soutenu avec courage tout le poids de la maison et peut-être l'eût-elle trouvé léger ; mais ce qui rendait sa tâche plus pénible, c'était de cacher ses efforts à André, c'était de chercher des prétextes à ses absences, profitant du sommeil de son mari pour aller gagner de quoi subvenir aux frais de sa maladie. Elle avait la douleur de voir qu'elle ne le trompait pas. André se taisait, mais le chagrin qu'il éprouvait de n'être qu'un sujet de peine pour sa femme et de misère pour ses enfants le rongeait intérieurement plus que son mal, et avançait l'instant de sa mort. Les dernières heures de son agonie furent bien tristes. Catherine avait jusqu'au dernier moment étouffé sa douleur ; sa bouche souriait et parlait d'espérance, pendant que son coeur était livré au désespoir. Mais lorsqu'elle vit qu'elle avait beau faire, qu'André s'en allait, elle voulait s'attacher à lui; elle l'entoura de ses bras, et passant d'une force d'ame héroïque à tout l'abandon de la douleur, ne pouvant plus le retenir, elle voulait le suivre. Quand elle reçut sur sa bouche son dernier soupir, on crut qu'elle allait expirer avec lui.
Lorsque Catherine revint de son évanouissement, elle vit à côté du lit funèbre deux petits enfants assis sur une misérable couche, la larme à l'oeil, le sourire à la bouche; elle vit sa vieille mère brisée par la douleur; ces trois êtres chéris avaient les yeux levés vers elle, leur seule espérance, elle comprit leurs regards — Tu as besoin encore de tout ton courage, pauvre femme, — se dit-elle. Relevant ses longs cheveux épars, essuyant ses larmes, elle alla presser ses enfans et sa mère contre son coeur, et trouva dans son courage des paroles consolantes. Sa constance dans son malheur fut aussi admirable que l'avait été son dévouement. Au milieu de l'émotion générale que causait son infortune, elle fut un modèle de force et de résignation. Deux jours après la mort d'André, temps nécessaire pour lui rendre les derniers devoirs, elle prit le chemin de la montagne. Les forgeurs la virent venir avec un sentiment profond de respect et de compassion. Ces hommes rudes n'osaient lui parler, de peur de s'attendrir et de l'attrister. — Pauvre femme dirent les habitants de Belviane en se mettant sur leur porte pour la voir passer, et la suivant tristement du regard. Son malheur fut ressenti comme une calamité qui aurait pesé sur tout le pays. Quand elle paraissait avec ses habits noirs sur la montagne, elle semblait jeter sur la vallée une ombre de tristesse. Elle reprit son train de voyages de la forêt à la forge de Quillan avec plus d'ardeur que jamais, et, malgré ses fatigues, sa santé et ses forces ne s'affaiblirent pas. Elle avait alors vingt-deux ans; beaucoup la trouvaient plus belle qu'avant son mariage; seulement son front était resté pâle depuis la mort d'André, et c'était un rare bonheur pour ceux qui l'aimaient de la voit sourire.
Il y avait un an environ que Catherine portait le deuil de son mari, c'était à la fin du mois de novembre, au temps des premières neiges, qui chassent les charbonniers de la forêt et retiennent les femmes de Saint-Martin au village. Les grues passaient depuis quelques jours par bandes nombreuses, annonçant un rude hiver. Cependant l'arrière-saison avait été belle; le mauvais temps n'était pas encore tout-à-fait arrivé; les travaux n'avaient pas cessé à la forêt, et Catherine continuait d'aller à la forge. Un jour que le vent du nord soufflait avec violence et durcissait la neige tombée la nuit en abondance, Catherine à la prière de sa mère qui se sentait troublée par une tristesse vague, resta toute la matinée à la maison. Mais, vers midi, le ciel s'éclaircit, l'air devint plus doux; et voyant les moineaux quitter leurs toits et courir sur la neige, elle eut envie de se mettre en route. — Il fait beau, dit-elle en regardant la montagne où brillait un rayon de soleil qui semblait l'appeler, je pourrai faire un voyage. Elle devait d'ailleurs toucher à la forge le salaire de plusieurs jours dont elle avait besoin, et il était à craindre que le lendemain le temps ne fût encore plus mauvais. Elle embrassa sa mère et ses deux enfants; une charge de charbon était toute prête chez elle; choisissant celle de ses deux ânesses qui avait le pied le plus sûr, elle partit pour la forge.
Comme elle voulait gagner du temps parce que la nuit arrivait vite dans cette saison, elle prit le chemin le plus court, mais aussi le plus dangereux, un étroit sentier qui courait le long de la crête de la montagne escarpée, sur les bords de Pierre-Lisse. Le curé qui, pour profiter du soleil, se promenait sur les bords de l'Aude où il venait souvent étudier un projet, sujet constant de ses préoccupations, apercevant Catherine au haut du précipice, frémit à l'idée du danger qu'elle bravait; mais, comme il la voyait aller d'un air libre et assuré; il la suivit des yeux jusqu'au détour de la gorge avec une sorte d'admiration, et se tranquillisa uu peu. Cependant, sur le soir, le temps s'assombrit tout a coup ; un ciel gris et morne s'abaissa sur la montagne, et il tomba du verglas. Le curé, déjà rentré chez lui, voyant arriver subitement la nuit et entendant cette pluie glacée qui fouettait les vitres, pensa à la pauvre Catherine, et alla s'informer chez sa mère si l'imprudente fille était revenue de la forge. Il trouva la vieille femme en prières et en larmes, agitée d'un cruel pressentiment; Catherine n'était pas encore de retour. Ne pouvant lui-même maîtriser un trouble secret, malgré le vent et la neige, il s'en alla vers la rivière, suivi bientôt d'un grand nombre de femmes, qui s'émurent comme lui en apprenant que Catherine, à cette heure, traversait sans doute la montagne. Le ciel était tout-à-fait noir; les flots rapides de l'Aude, qu'on apercevait à peine, se précipitaient vers la Pierre-Lisse; on entendait venir de l'abîme un bruit semblable au sourd grondement de la mer, et par intervalles les rugissemens des raffales qui s'engouffraient dans la gorge. L'oeil habitué à saisir les formes de la montagne pouvait seul distinguer, comme une ligue à demi effacée, le sentier tracé au-dessus de la Pierre-Lisse. Le curé et les femmes qui l'avaient accompagné avaient constament les regards fixés sur ce sentier presque imperceptible, attendant avec anxiété qu'il y parût une ombre, et se livrant tour à tour à mille conjectures toutes différentes les unes des autres.
— Elle aura vu le mauvais temps, disait une femme; elle sera restée à Belviane.
— Oh non disait une autre, elle n'aura pas voulu laisser sa mère dans la peine.
— Elle sera passée au moins par l'autre chemin.
— Mais la pluie n'est venue que lorsqu'elle avait déjà pris celui-ci.
Pendant ces alternatives de craintes et d'espérances, on vit plusieurs fois remuer quelque chose le long du sentier de la Pierre-Lisse; on crut que c'était Catherine : plusieurs voix l'appelèrent, mais les sifflements d'un vent furieux, échappé de la gorge répondaient seuls à ces voix; le point noir se fondait dans la teinte uniforme de la nuit; ce n'était sans doute qu'un nuage qui, en passant, avait rasé la montagne. A chaque méprise les alarmes augmentaient, l'effroi gagnait tous les cœurs; le vent, les flots, l'air, le ciel, étaient remplis de terreurs. Les ténèbres s'épaississaient de plus en plus; on ne distinguait plus rien, ni rivière, ni montagne; on gardait un morne silence dans l'espoir de saisir pendant une lugubre pause des raffales, quelque bruit qui annonçât l'arrivée de Catherine. Après une heure d'angoisses, en effet le braiement de son anesse se fit entendre dans l'éloignement. – La voilà, la voilà, crièrent alors toutes les femmes avec des transports de joie, et plusieurs d'entre elles se précipitèrent sur un mauvais pont en bois sans garde-fou, au risque de tomber dans l'eau car elles ne voyaient pas où elles mettaient les pieds, et coururent vers le sentier de la montagne. Un moment après elles revinrent consternées; elles ramenaient bien l'ânesse, mais Catherine, elles ne l'avaient pas vue. – La malheureuse; elle sera tombée dans la gorge s'ecria-t-on avec un sentiment de terreur. Puis l'effroi fit place à la douleur; des larmes coulèrent de tous les yeux, des gémissements remplirent l'air et se mêlèrent aux sifflements du vent. On attendit long-temps, on appela de nouveau aucune voix humaine ne répondit; Catherine ne vint pas. Il n'y avait parmi cette foule éplorée, aucun homme qui pût se dévouer pour aller la chercher; tous les hommes jeunes de Saint-Martin étaient encore à la forêt. Muettes de frayeur, immobiles toutes ces femmes seraient restées jusqu'au lendemain à écouter, dans une sorte d'anéantissement, les bruits lugubres de cette épouvautable nuit. Le curé les tira de leur stupeur. A l'église ! à l'église! cria-t-il, que la cloche appelle au village tous les habitants !
On courut à l'église et la cloche fit entendre des sons précipités, comme des voix d'hommes en peril qui répandirent l'alarme dans la forêt des Fanges. Les charbonniers arrivèrent; le curé demanda des hommes de dévouement; il s'en offrit un grand nombre et, trop âgé lui-même pour les suivre, il organisa du moins leurs bandes, dirigea leurs recherches. Ils partirent armés de flambeaux et de bâtons ferrés; bientôt on entendit le nom de Catherine retentir sur la monontagne, et l'on vit les flambeaux, qui jetaient des lueurs rouges sur là neige, courir çà et là comme des météores. Ils parcoururent tous les chemins, pénétrèrent dans toutes les cavernes, mais ils ne trouvèrent pas la malheureuse Catherine; ils ne pouvaient pas méme apercevoir la trace de tel pieds; la neige qui tombait couvrait leurs propres pas à merure qu'ils avançaient. Ils arrivèrent à Belviane et demandèrent si on ne l'avait pas vue; On l'avait vue passer un peu avant la nuit, se dirigeant vers le sentier de la Pierre-Lisse. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement dans le village et émut tous les hàbitans; les maisons, qui s'étaient déjà fermées, se rouvrirent comme-en plein jour; les rues se remplirent de monde. On n'était que trop persuadé que Catherine était tombée dans la gorge ; déjà un pareil événement était arrivé, il y avait une dizaine d'années, et avait laissé dans le pays une douloureuse impression. Si une mort imprévue cause de l'émotion dans les villes, que ne doit-elle pas faire dans les campagnes, lorsqu'elle frappe une personne aimée et connue de tous, lorsque cette mort funeste finit une misérable existence, dont les dangers et les peines sont communs à tous! Il est difficile de se faire une idée de l'état d'agitation des esprits, depuis Saint-Martin jusqu'à la forge de Quillan. Une troupe de femmes s'était réunie dans une maison située tout près de la rivière, et demandait à grands cris que, vivante ou morte, on leur apportât Catherine. Des hommes parcouraient les bords de l'Aude, et, lorsqu'ils passaient devant cette maison, ils étaient assaillis par d'amères plaintes, de la part de ces femmes, qui s'en prenaient à eux de ce qu'on ne la trouvait pas. Leur sensibilité s'exaltait de plus en plus, et bientôt trop émues pour attendre, elles coururent elles-mêmes vers la rivière et se répandirent sur les bords.
Toute la nuit se passa en inutiles recherches ; mais le matin, dès qu'il fit jour, des forgeurs trouvèrent le corps près de la prise d'eau de l'usine, dans un coin où la rivière était calme. Il fut retiré de l'Aude et porté sur la route. En un instant, toute la population de Belviane accourut. Les femmes se jetaient en pleurant sur le corps de Catherine et voulaient toutes le porter à l'église de Belviane. Ce transport se fit dans le désordre et l'égarement delà douleur. Le calmene se rétablit un peu dans les esprits que lorsqu'on vit Catherine déposée sur des bancs au milieu de l'église. Un Christ fut placé sur son sein, et Chacun put repaître ses yeux du spectacle déchirant de la pauvre Catherine morte. L'infortunée, en tombant dans la Pierre-Lisse, avait sans doute frappé de la tête contre un rocher, le sang souillait son visage; une femme le lava et l'on vit sur son beau front un trou saignant encore qui en altérait la pureté. Mais il y avait dans le reste des traits une sublime beauté qu'on était avide de contempler, un mélange de souffrance et de douceur, touchante empreinte que son ame, en prenant son essor avait laissée sur son visage, comme l'image de toute sa vie. La majesté de la mort entourait de tout son éclat cette vie si pure. Chacun s'approchait du corps avec une sorte de vénération, secouait sur lui le buis bénit, et s'agenouillait en versant des larmes. Le corps resta exposé plus de deux heures, durant lesquelles on alla prévenir le curé de Saint-Martin et on fit la bière. Lorsque cette bière entra dans l'église, lorsqu'on vit déployer le linceul qui devait envelopper Catherine, lorsqu'elle disparut dans ses plis et fut déposée dans le cercueil, ce fut une désolation qu'on ne saurait dire. Le curé de Saint-Martin arriva dans ce moment; en voyant une si grande affliction il ne put retenir sa douleur et mêla ses larmes à celles de la foule. On découvrit à ses yeux le visage de Catherine; il jeta sur lui un dernier et tendre regard où se peignirent des regrets amers et une douce espérance divine. Ce beau visage disparut pour toujours sous le linceul, et une planche fut clouée sur la bière en présence de tous les assistants. Des cierges s'allumèrent autour du cercueil; l'office des morts commença, mais des sanglots au lieu d'hymnes funèbres remplirent l'église.
On fit à Catherine un convoi qui n'avait jamais eu d'exemple; personne n'y manqua des populations de Saint-Martin et de Belviane et, bien que la route de la montagne fût longue et pénible, le corps fut porté à bras par des femmes. Le soleil ne brillait pas au ciel, mais une lumière douce et mélancolique était répandue dans l'espace, réfléchie par la neige de la montagne. La nature entière était tendue de blanc. Des bandes de noirs corbeaux qui planaient dans l'air ou se posaient sur des roches faisaient seules des taches dans le ciel et sur la terre. Le cortège cheminait avec recueillement et gravissait lentement la montagne de Quirbajou. Les chants des morts s'élevaient de moments en moments, et dans les intervalles régnait un morne silence. A l'impression triste de la cérémonie se joignait l'émotion que faisait naître la vue du curé déjà vieux, qu'il fallait soutenir et aider à monter. Parvenu au sommet de Quirbajou, le convoi s'arrêta un moment pour reprendre haleine. On apercerait de là les deux églises de Saint-Martin et de Belviane; les cloches balancées dans l'air pleuraient Catherine et leurs sons plaintifs venaient se méler sur la montagne; on pouvait voir aussi la route entière où s'était renfermée la vie de la pauvre femme; cette route qu'elle avait parcourue si souvent seule, elle la suivait, hélas ! pour la dernière fois, accompagnée d'une nombreuse population que sa mort avait plongée dans le deuil.
On arriva à Saint-Martin avant la nuit; le convoi passa devant maison de Catherine. Les cris de ses malheureux enfants en sortirent; les infortunée demandaient leur mère; un douloureux intinct leur disait sans doute que c'était elle qu'on portait en terre. Quant à la vieille infirme, on ne l'entendit pas; ellr était étendue depuis le matin sur son lit, privée de sentiment. Après ses premiers élans, la douleur publique avait été muette et recueillie pendant la route; mais au cimetière, lorsque la bière fut descendue dans la fosse, elle éclata de nouveau. Le curé ayant élevé la voix, les gémissements cessèrent et sa parole fut écoutée dans un religieux silence.
« Mes enfants, dit-il d'abord d'un accent plein de l'émotion commune, mais bientôt d'une voix ferme qui releva les âmes de leur abattement, vous pleurez tous Catherine, comme une sœur bien-aimée que vous auriez perdue et moi aussi, je l'ai pleurée avec vous, comme un père pleurerait la fille de son cœur. Vous donnez tous vos regrets à la créature de Dieu la plus parfaite et la plus aimable. Mais Catherine doit être quelque chose de plus sacré pour vous qu'un objet de votre humaine affection. Dieu vous l'avait donnée comme l'exemple de la vertu la plus pure; Dieu a voulu qu'elle fût chère à vos cœurs pour que la douleur de sa perte ne fût point stérile pour vous, pour que sa mort portât son fruit comme sa vie. En voyant périr si misérablement celle que vous aimiez comme une soeur, vous penserez aux dangers que courent tous ceux que vous chérissez car le gouffre est là qui hurle encore et demande une nouvelle proie. Pendant que votre douleur est encore saignante, prenez la résolution courageuse de les arracher à ces périls qui les menacent. Mes enfants vous savez ma tendre sollicitude et mon amour pour vous, vous savez combien j'ai souffert en voyant vos femmes et vos filles gravir la montagne pour gagner un morceau de pain souvent au péril de leur vie. Mon Dieu ! disais-je, si je pouvais l'abaisser cette rude montagne, pour les femmes qui allaitent leurs enfants, pour les filles qui nourrissent leur mère, anges du ciel, donnez-leur la main. Je demandais à Dieu qu'il fit pour vous un miracle, et celui qu'on n'invoque jamais en vain m'a envoyé une bonne pensée. Votre chemin sera aplani, les pierres rudes à vos pieds en seront ôtées, tous les obstacles s'évanouiront. J'ai étudié les lieux, j'ai médité un projet, et ce sera vous qui l'exécuterez sans effort. Pous cela, il ne faut qu'un peu de courage, un léger sacrifice au bien public; il ne faut pendant quelques jours que le concours de vos bras. Une route peut s'ouvrir dans l'intérieur de la Pierre-Lisse. Il n'est point d'abîme qu'avec l'aide de Dieu l'homme ne puisse combler, point de roc immense qu'il ne puisse renverser de sa base et semer sous ses pas en poussière. Cette route est possible, je vous le garantis, j'y sacrifierai tout ce que je possède et ce qui me reste de vie. Vous, mes enfants, vous me promettez de me seconder. Habitants de Belviane, ne ferez-vous rien pour vos frères de Saint-Martin ? Vous vous réunirez tous à moi, j'en ai l'assurance, j'en crois l'émotion de vos cœurs, les mots confus qui sortent de votre bouche; demain matin, rendez-vous à l'église; après la messe, nous irons à la Pierre-Lisse, et nous ouvrirons cette route qui doit finir votre misère. »
Ce discours produisit sur l'assemblée tout l'effet que le curé pouvait en attendre. Quand il eut cessé de parler, un long murmure d'approbation et de dévouement s'éleva. On voulait aller à l'instant à la Pierre-Lisse; mais comme la nuit arrivait, l'ouverture de la route fut remise au lendemain. Le silence se rétablît, et la fosse de Catherine se ferma dans le deuil et le recueillement; les larmes étaient séchées tous sortirent du cimetière le cœur rempli de généreuses pensées.
Le lendemain, l'église de Saint-Martin ne pouvait pas contenir la foule qui s'y rendit. Il vint un grand nombre d'habitants de Quillan de Daxat et de tous les endroits environnants où la nouvelle de la mort de Catherine et du projet du curé s'était répandue. Ou assista à la messe avec des pics, des pioches et des pinces. Instruments et hommes furent bénis; et après une courte et chaleureuse exhortation, qui remplit tous les assistants de l'esprit de Dieu, ils partirent, le curé à leur tète, armé lui-même d'une pioche, et s'en vinrent à la Pierre-Lisse. Le roc fut entamé. Ainsi s'ouvrit cette route, œuvre non moins digne d'admiration, pour le mérite de son exécution que pour les généreux sentiments qui la firent entreprendre.
Le curé Armand eut le bonheur de la voir achevée et il jouit encore quelques années de la reconnaissance du pays. Cette route n'apporta pas la richesse dans le village de Saint-Martin, mais elle y fit naître du moins une grande sécurité et bientôt même on y ressentit quelque aisance. La vie y devint plus facile; les femmes s'en allèrent à Quillan sans danger et sans fatigue; leurs voyages, si pénibles auparavant, ne furent qu'un jeu pour elles. Il semblait à ces pauvres gens qu'on leur eût ôté la montagne de dessus la tète. Le contentement qu'éprouvait le curé d'avoir soulagé la misère de son pauvre troupeau, la seule satisfaction de se dire que son bien-être était son ouvrage, ce doux prix de la conscience eût suffi à son coeur, cependant une récompense plus éclatante lui était due: il obtint celle qui aurait pu le mieux flatter sa vanité (s'il avait eu la moindre vanité), l'insigne honneur d'entendre son éloge de la bouche même de l'empereur. Quoiqu'il n'eût jamais eu d'autre mobile de ses actions que la plus pure charité, il dut lui être doux de se voir honoré par celui qui était la gloire de la France; il dut lui être doux au moins de reconnaître dans le chef d'une grande nation un homme sensible et juste, dont la faveur allait chercher les bonnes œuvres dans les coins les plus reculés de l'empire. C'était à l'époque où la France entière ressemblait à un vaste camp tout hérissé de baïonnettes, retentissant d'armes et de roulements de tambours; d'innombrables bataillons traversaient sans cesse nos villes, tous leurs vieux et glorieux drapeaux allant du nord au midi de l'Europe. Napoléon passa avec eux à Toulouse. Un peuple immense était venu pour le voir passer. L'empereur, qui avait craint de ne recevoir qu'un accueil froid dans cette ville, de la trouver rebelle, la vit enthousiaste et asservie à sa gloire. Jamais l'exaltation qu'excitait partout sa présence n'avait eu à ses yeux de plus vifs transports. Il s'en montra reconnaissant, il combla la métropole du midi des marques de sa munificence. Il ne devait s'arrêter que quelques heures à Toulouse; il se trouva si bien au milieu des témoignages spontanés de son dévouement qu'il y demeura plusieurs jours. Ce furent des jours d'une véritable ivresse; les rues plantées d'arbres s'étaient couvertes de tentes, comme aux plus beaux jours de ses fêtes religieuses. Aux premiers rayons du soleil un immense murmure s'élevait dans la ville et parcourait les rues précédant et suivant l'empereur, qui semblait porté par les flots d'un peuple en délire.
Mandé par l'archevêque, le curé Armand arriva à Toulouse au milieu de ces fêtes. Ce n'était pas un prêtre qu'une vertu orgueilleuse élevait au-dessus de tout ce bruit dont la ville était pleine, et qui, pour la première fois, frappait son oreille, mais un homme simple de cœur, sensible et bienveillant à tous. En entendant ces cris d'amour et de joie, il fut profondément ému et il ressentit quelque peu de frayeur en lui-même, en pensant qu'il allait être présenté à celui qui était l'objet de cette sorte de culte. Lorsqu'il se trouva au palais au milieu de la brillante élite du pays, il se tint humblement de côté, se demandant ce que lui, pauvre curé de hameau, y était venu faire. Mais dès que l'empereur parut, au moment où les premiers rangs s'inclinaient devant lui, il sut d'un coup d'œil embrasser toute l'assemblée et y découvrir le modeste et respectable curé. D'un regard il lui ouvrit un chemin au milieu de cette foule de gens titrés, d'un mot il lui fit un piédestal, et la tête blanche du vénérable curé rayonna près de la sienne; la vertu et le génie confondirent un moment leur auréole.
— Monsieur le curé, dit l'empereur, j'ai su ce que vous avez fait; vous avez mérité toute mon estime. C'est ainsi que j'entends et que j'aime la religion, toute de charité active et utile. En présence de tous comme en particulier, il lui donna le plus haut témoignage de sa satisfaction. Il offrit une noble récompense à ses vertus. Désirant ouvrir un champ plus vaste à l'exercice de sa charité, il voulut le faire évêque mais la générosité et la grandeur de l'empereur ne l'emportèrent pas sur le désintéressement et la modestie du curé Armand. Il s'excusa sur sa vieillesse, sur ses faibles moyens, sur son amour enfin pour ses bons villageois, qu'il ne voulait pas quitter. Il demanda seulement pour réparer son église, quelque peu d'argent que Napoléon lui accorda avec ce sourire sympathique dont il payait les cœurs incorruptibles. L'empereur exigea seulement qu'il acceptât la croix de la Légion-d'Honneur.
— Prenez-la, lui disait-il en lui présentant une croix ; lorsqu'un soldat mutilé la verra sur votre poitrine, il sera plus fier de la sienne.
Le curé Armand sortit du palais plus ébloui de la majesté simple qui l'avait frappé dans l'empereur que de tout ce magnifique appareil qui l'entourait, bien convaincu que ce n'était ni le succès, ni la puissance qui l'avaient fait si imposant à la foule, mais sa propre grandeur.
Quelques hommes de Saint-Martin, venus à Toulouse avec leur curé, l'attendaient à la porte du palais. Quand ils le virent arriver avec sa croix Suspendue sur la poitrine à un beau ruban rouge, ils parurent plus heureux et plus enorgueillis de cet honneur qu'il ne l'était lui-même. Il s'avança cependant, souriant d'aise de les voir tout ébahis; mais en passant devant les sentinelles qui lui portèrent les armes, il montra un modeste embarras pour leur rendre leur salut : il découvrit timidement la tête, et le rouge delà pudeur monta au front du vieillard comme au front d'un enfant.
Tous ces nobles honneurs, ce culte, ce bruit, cette ivresse de la puissance, ne le troublèrent pas. Il aurait pu prendre une place parmi les grands de la terre : il ne la dédaigna pas, il témoignait au contraire tous ses respects pour les renommées honorables, pour les distinctions méritées dans le monde; mais il désirait pour lui moins d'éclat, il voulait une scène moins élevée, où le coeur pût jouer le premier rôle; il préférait l'amour de ses villageois aux hommages des hommes; il revint à Saint-Martin aussi pur de toute ambition, aussi simple qu'il en était parti.
II ne put cependant quoi qu'il fît, se soustraire aux honneurs qui lui furent rendus sur sa route, depuis Pamiers jusqu'à Quillan. Il était connu dans l'Ariége ; il voulut, avant de rentrer dans son modeste réduit, dont il pensait ne plus sortir, car il se faisait bien vieux, dire à ses amis un dernier adieu. Il était venu à Toulouse par la plaine, il s'en retourna à Saint-Martin par la montagne; et comme il n'y avait pas de voitures sur sa route, il s'en alla à cheval à petites journées, passant par Pamiers, Foix, Lavelanet, Chalabre. Des hommes de Quillan et de Saint-Martin se plaisaient à le précéder de quelques heures et à annoncer son arrivée.
Sa bonne renommée comme une douce odeur portée par les brises des montagnes était descendue dans ces villes; on y connaissait sa vie de pieté, d'amour, de bienfaisance, cette vie qui fut une bonne œuvre continuelle; il venait d'ailleurs de voir l'empereur de lui parler; il portait sur lui comme un reflet de sa gloire; c'étaient là des motifs assez puissants pour attirer la foule à sa rencontre, et on lui faisait à son passage dans chacune de ces villes une superbe réception. Mais c'est surtout à Quillan que l'ovation fut complète. Le curé Armand y arriva un jour de fête. Lorsqu'il atteignit le col de la Visla, d'où le regard plonge au loin sur la ville, et découvre la vallée qu'arrose l'Aude, il vit échelonnées sur le chemin sinueux de la montagne les populations de Quillan, Belviane et Saint-Martin qui l'attendaient sans doute, car dès qu'il parut des cris de joie retentirent dans l'air, et tous les bras s'agitèrent pour le saluer. Il descendit la montagne porté plutôt que conduit par tout ce peuple; et monté sur son petit cheval, il fit une entrée vraiment triomphale à Quillan.
Le curé Armand ne quitta plus Saint-Martin. Il vieillit sans que l'ardeur de sa charité s'affaiblît ; les doux rayons de ses yeux gardèrent jusqu'au dernier moment toute la chaleur de son ame; lorsque sa voix et ses mains tremblèrent, sa vie sembla s'être retirée au cœur et jamais peut-être il ne donna plus de preuves de l'excellence de sa nature. Il mourut doucement, en s'éteignant comme le dernier sourire d'un beau crépuscule. Son ame se détacha sans effort de la terre; elle s'en alla un jour qu'il se chauffait au soleil devant la porte du presbytère. Sa tête s'inclina sur sa poitrine avec un petit gémissement. Une femme qui le vit pâlir l'appela : Monsieur le curé ! Il ne répondit pas. Elle toucha sa main; elle était déjà froide. Alors elle jeta de hauts cris, elle appela au secours. D'autres femmes accoururent, elles entourèrent le curé, s'empressèrent auprès de lui avec cette émotion et ce trouble de tendres filles qui voient mourir leur père : elles lui prodiguèrent les soins les plus touchants; mais il était mort.
J.-L. Lugan.